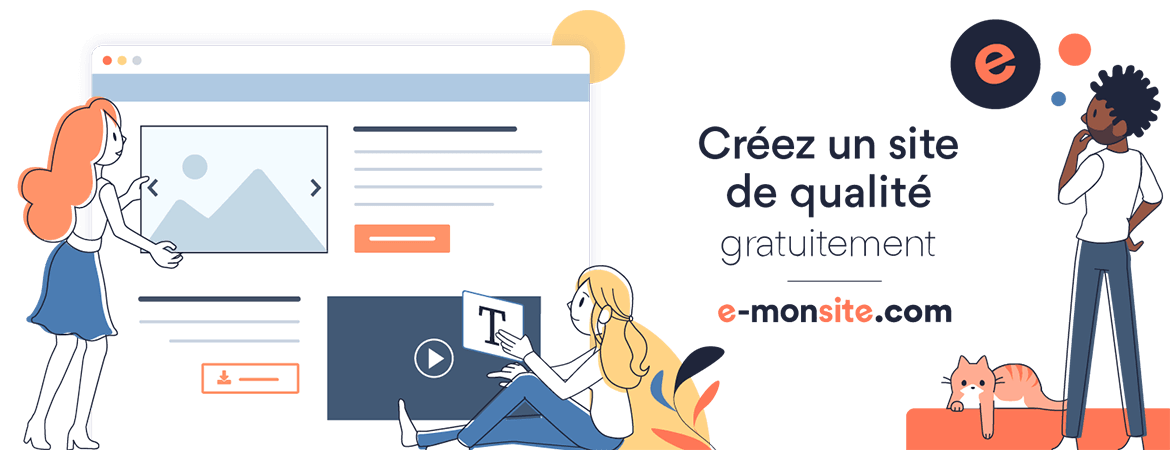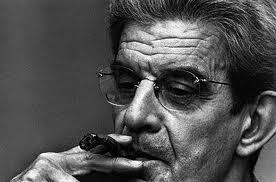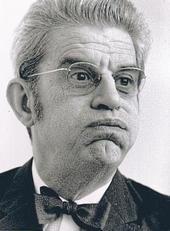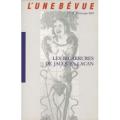L'ERREUR de LACAN
La non transgression linguistique de Lacan
Le psychanalyste Jacques n'est hélas pas parvenu à aller au bout de son étude du signifiant. Prisonnier d'un savoir linguistique saussurien, il n'a jamais osé franchir vaiment la barre signifié/signifiant. Il a cependant bien compris la primauté du signifiant et a inversé l'algorithme saussurien en s/S, signifiant/signifié. La barre instituée par Saussure est en réalité le symbole des refoulements originaires de la langue maternelle lors des étapes de transmission/acquisition, totalement omises de la réflexion sausssurienne. Lacan ne peut appréhender alors que le jeu des signifiants au dessus de la barre, sans comprendre qu'il puisse exister des unités inconscientes référent/signifié/signifiant qui construisent tous nos mots, qui ne sont donc plus les plus petites unités de sens de la langue, mais celles de l'expression orale et écrite. Une conception inverse de celle de Saussure.
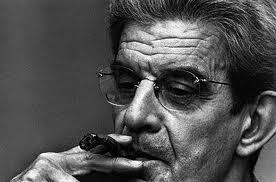
L'expérience psychanalytique de Lacan lui permet de mettre en lumière qu'il n'y a pas d'inconscient sans langage et que l'inconscient, lui-même, a la structure d'un langage. Mais il n'est pas toujours facile de suivre les arcanes alambiquées du style lacanien. D'après lui, la discipline linguistique tient «dans le moment constituant de l'algorythme S/s, Signifiant/signifié, le sur répondant à la barre qui en sépare les deux étapes».
Pour reprendre le mot arbre, Lacan affirme que «ce n'est pas seulement à la faveur du fait que le mot barre est son anagramme, qu'il franchit celle de l'algorythme saussurien. Car, décomposé dans le double spectre de ses voyelles et de ses consonnes, il appelle avec le robre et le platane les significations dont il se charge sous notre flore, de force et de majesté». Il semble que Lacan, même s'il n'en tire aucune conclusion linguistique, ait bien perçu que le signifié arbre était spécifique au français et renvoyait à des référents habituels de la flore de France. Mais, et c'est à la fois amusant et défoulant de le souligner, quand il attribue majesté et force au signifié arbre français, il définit, à son insu, le sens inconscient de la séquence littérale ar inaugurant le mot arbre qui, comme énoncé ultérieurement, marque la prééminence, le sommet ou la menace !

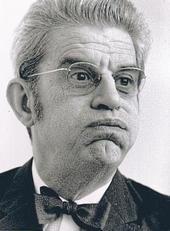
Pour Lacan, le signifiant prime sur le signifié. Le franchissement de la barre entre signifié et signifiant se ferait selon lui par le jeu des signifiants entre eux, chez chaque individu, avec un glissement incessant du signifiant sur le signifié. Ce processus se manifeste, en psychanalyse, à travers les formules de la métonymie et de la métaphore, que Lacan nomme les « lois du langage » de l’inconscient.
.
1) La métonymie qui "rend compte du déplacement dans l'inconscient",est une figure de style où un signifié est exprimé au moyen d'un signifiant désignant un autre signifié qui lui est uni par une relation nécessaire : la cause pour l'effet, le contenant pour le contenu, la partie prise pour le tout. Ainsi on dit "boire un verre" pour boire le vin qu'il contient, ou une voile pour désigner un bateau. La métonymie, si inventive soit-elle, s'appuie sur un rapport de contiguïté, donné par la langue elle-même. Ainsi le signifiant arbre cache une forêt de signifiés, dont la densité dépend de la richesse des champs sémantiques propres à chaque individu. Nous rangeons inconsciemment les mots dans des sortes de «tiroirs» sémantiques : monde vivant / végétaux / forêt / arbre / chêne / branche / bois / lignite... Certes, le mot bois, au sens de matière ligneuse de l'arbre, dérive par métonymie de bois au sens de forêt - la matière étant prise pour l'ensemble, mais pourquoi précisément, c'est cette partie-là, et seulement celle-là, qui est apte à la métonymie. Pourquoi branches ou feuilles ne représentent pas le bois ? Cette métonymie ne s'explique pas en anglais où la matière du bois se dit timber et le bois (forêt) wood. Il y a bien dans la matière du signifiant des messages précis qui résonnent, mais Lacan n'a pas détecté sous l'écorce phonique du signifiant sa substantifique moelle. Il serait dommage (en l'exprimant avec un peu d'humour) que l'histoire de la psychanalyse mondiale, ne le retienne que comme un rejeton, une petite branche sans défense, greffée sur la souche freudienne en voie de décomposition.
2) «La langue latine étant la vieille souche, c'était un de ses rejetons qui devait fleurir en Europe». Cette métaphore d'Antoine Rivarol introduit la seconde figure de style par laquelle Lacan entend le jeu et la fonction des signifiants : «La formule de la métaphore rend compte de la condensation dans l'inconscient». Un mot pour un autre, un mot concret pour un mot abstrait, un transfert de sens par substitution analogique, telle est la définition de la métaphore, figure de style plus fréquente et plus apte à la poésie. La racine du mal, l'arbre de la connaissance, la forêt de symboles, le jardin de la paresse, l'écheveau du temps, l'automne des idées, les fleurs du mal de Baudelaire sont des métaphores. Le mélange signifié concret/abstrait ne nuit pas à la compréhension. Pourquoi ? Où se situe l'analogie ? Ne s'agit-il que d'images globales ou de relations entre certaines parties des signifiants ? Quand on regarde d'un peu plus près deux exemples de métaphores de Baudelaire, le vin du souvenir et l'alcôve des souvenirs, on peut noter que le verbe souvenir au passé simple se dit souvint, rimant avec le signifiant vin dont l'abus fait devenir saôul (lien soul -vin).
Le signifiant alcôve, proche phonétiquement d'alcool, rappelle ce vin d'autant plus qu'il porte cette lettre v (vigne, vendange, vin, viticulture) et rappelle par "al" le Mal des Fleurs. Vals(e) alambiquée (hic!) des signifiants ! Pourquoi l'alcoolique se versa-t-il un dernier verre de vin, qu'il vida, cul sec et l'oeil humide ? Faut-il être devin pour concevoir qu'il avale d'un trait avide ses gros maux ? Comment ne pas entendre dans le flot des mots que, soudain volubile, il déverse et vomit, la motivation réelle de ses maux ? Arbitraires les lettres ? Si l'on visualise le V de haut en bas, n'est-il pas une sorte d'entonnoir, une figure symbolique du verre, du vase ou du pot de vin?

Les eaux minérales qui se boivent au verre viennent-elles de Vichy, Vittel, Volvic, Evian, Vals, Wattwiler, Contrexeville, Jouvence, par hasard. Le Saint Patron des Vignerons se nomme t-il Vincent par pure convention ? In vino veritas, dit le dicton latin.

La métonymie et la métaphore ne créent pas de nouveaux signifiants, ce sont des figures conscientes qui se contentent d'accroître la polysémie et ne sont pas à l'origine de la lexicogénèse. Elles ne sont pas les lois de l'inconscient collectif dont la langue est une toute autre affaire, car ses unités sont les briques créatrices qui on formé nos mots et continuent de les faire évoluer.
«Un soir l'âme du vin chantait dans les bouteilles
Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,
Un chant plein de lumière et de fraternité! »
Charles Baudelaire
Lacan avait bien saisi que le langage de l'inconscient jouait avec le matériau du signifiant. Comme il l'écrit, à juste titre, «l'inconscient ne connaît que les éléments du signifiant», il «est une chaîne de signifiants qui se répète et insiste».Lacan relève le mode selon lequel l'inconscient opère, ainsi que Freud l'avait décelé par la production de condensations et de déplacements le long des mots «sans tenir compte du signifié ou des limites acoustiques des syllabes». En reprenant l'oeuvre de Freud et en la recentrant sur le langage, Lacan va plus loin, il affirme qu'au commencement était la chaîne des signifiants, un signifiant préséant au signifié, dont la structure commande les voies du réseau du signifié. «Le mot n'est pas signe, mais noeud de signification», qu'il aurait dû dénouer, puisque l'analyse est étymologiquement l'art de délier les noeuds ! Mais en donnant un coup de ciseaux entre les deux plans signifié/signifiant du langage, Lacan tel Alexandre sectionnant le noeud gordien, incapable de le défaire devant son apparente complexité, explique alors que «noeud veut dire la division qu'engendre le signifiant dans le sujet... divisé par le langage», mais continue d'affirmer de façon répétée que «l'inconscient a la structure radicale du langage» qui lui-même «implique l'inconscient», qu'il en est la condition. En résumant, Lacan nous dit que l'inconscient est un langage, constitué des éléments du signifiant, préexistant au signifié. Il va jusqu'à avancer que l'inconscient est pure affaire de lettre, et comme tel, à lire !«Nous désignons par lettre ce support matériel que le discours concret emprunte au langage... Ce support matériel ne se réduit pas aux lettres de notre alphabet, qui ne sont jamais qu'un des modes». Avec le risque, comme dit Lacan, d'apprendre en s'alphabêtissant. «Tout découpage du matériau signifiant en unités, qu'elles soient d'ordre phonique, graphique, gestuel ou tactile, est d'ordre littéral. Si toute séquence signifiante est une séquence de lettres, en revanche, pas toute séquence de lettres est une séquence signifiante». Voilà, Lacan est parvenu à définir presque complètement les caractéristiques du langage de l'inconscient, jusqu'à préciser qu'il existe des unités faites de séquences de lettres dont certaines sont signifiantes et d'autres non, mais il n'est pas parvenu à découvrir le véritable code.
Pourquoi le sens systématique de certaines séquences répétées du signifiant lui a échappé ? Trop intelligent pour découvrir un code finalement relativement simple, peut-être ? Il écrit que le sujet est divisé par le langage mais ne poursuit pas sa logique en ne comprenant pas que cette division est due à l'existence de deux langages, un inconscient et un conscient, un immédiat structuré par l'hémisphère droit et un média conditionné par apprentissage dans l'hémisphère gauche, le premier étant préséant au second. Trop conditionné sans aucun doute par une remarquable formation linguistique, il n'ose franchir la barre signifiant/signifié, il ne 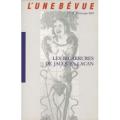 transgresse pas l'enseignement de ses amis linguistes et au contraire leur prête main forte et, alors, se fourvoie: «le signifiant existe en dehors de toute signification, il n'a pas fonction de représenter le signifié». Avec un peu d'humour, il s'agit là d'une bévue" lacanienne, hélas pas la seule! (unbewust = inconscient ou plutôt insu en allemand).
transgresse pas l'enseignement de ses amis linguistes et au contraire leur prête main forte et, alors, se fourvoie: «le signifiant existe en dehors de toute signification, il n'a pas fonction de représenter le signifié». Avec un peu d'humour, il s'agit là d'une bévue" lacanienne, hélas pas la seule! (unbewust = inconscient ou plutôt insu en allemand).
Comme je l'évoque depuis 1994 dans plusieurs ouvrages : Maux à mots, Entendre les mots qui disent les maux, l'hystérie tome à l'O., nous avons perdu la motivation des mots et n'entendons plus et ne lisons plus dans nos mots actuels les vestiges sonores ou graphiques d'une langue archaïque, que pourtant l'inconscient collectif langagier a conservé intacts. La simple litanie plaintive de mots qu'entend quotidiennement le médecin de famille à l'écoute de ses patients devrait mettre la puce à l'oreille au linguiste débutant et au psychanaliste lacanien. Avec quelque humour, on peut la résumer ainsi, telle la rengaine d'une vieile chanson :
"Aîe mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque"
" Docteur qu'est-ce que je dérouille, j'ai les genoux tout rouillés, la tête qui s'embrouille, je m'sens vasouillard, j'ai la voix éraillée et la vue qui se brouille, je m'sens barbouillé, mon ventre gargouille, grevouille ou rebouille (franc-comtois), j'ai la gorge qui grattouille, je crachouille, toussaille, je rancoye (comtois), mon coeur défaille; ça me tiraille dans le poitrail, j'ai un caillou dans un rein, un caillot dans une veine, je suis mouillé de chaud, bouillant de fièvre. Je m'suis fait une entaille, m'sis planté une échaille, m'suis brûlé avec de l'eau bouillante. Je suis grassouillette, rondouillarde, n'ai plus guère de cheveux sur le caillou, j'ai vraiment une sale bouille ce matin, quand j'urine ouille ouille, j'ai dû attraper la chtouille. Et il ne faut pas oublier la grand-mère qui déraille et le grand-père qui se souille. Pas étonnant que certains se taillent les veines ou se jettent à la baille, voire avalent un bouillon d'onze heures.
La vie des gens, des ouailles que nous sommes, en général et en détail, ressemble à une succession de cris étouffés sous forme de radicaux onomatopéiques, de suffixes qui devraient nous avertir du risque de douleur, mais que nous ne savons plus du tout discerner! Les onomatopées de la douleur aïe et ouille sont présentes dans une grande partie du lexique français, notamment dans la langue dite vulgaire. Ils marquent de leur empreinte phonétique nos mots conscients démotivés tels des codes de risque de douleur physique ou psychique que nous n'entendons plus, car notre conscience à la mémoire sélective, n'est devenue sensible qu'au sens global des mots. La perception sémantique consciente a éteint la perception phonétique reléguée dans le non sens et réservée aux jeux de mots. Comme le formulait avec justesse Henry de Montherlant. le mot a étouffé l'expression directe de notre ressenti, l'a enveloppé dans le paquet sémantique hermétique de sa globalité au point que « nos émotions sont dans nos mots comme des oiseaux empaillés», et ne peuvent que recourir aux cris ou aux mimiques pour s’exprimer, se communiquer et cela de façon instinctive. La répression de l'expression émotive est en effet un conditionnement familial, scolaire et social d'une redoutable efficacité. Observons les petits enfants qui pleurent pour un rien, passant des pleurs aux larmes en quelques secondes, et comparons avec un adulte dans le métro ou sur son lieu de travail!
«Aïe» est apparu en français en 1473 comme interjection onomatopéique de la douleur et par extension d’une surprise désagréable ; de même «ouïe» exprime l’émoi douloureux. Le grand dictionnaire françois et flamand, le Richelet de 1706, définit «ahi, ach, och» comme interjections marquant un sentiment de l’âme plein de douleur. L’onomatopée “aïe” ou “ouille” isolée traduit plutôt une douleur aiguë ou un désagrément subit, tandis que la répétition du type «aïe aïe aïe» ou «ouille ouille ouille” exprime plutôt la crainte d’une douleur ou d’une difficulté. Perspicace, Lacan avait bien saisi que le langage de l'inconscient est une chaîne de signifiants qui se répète et insiste, mais malgré cette analyse pertinente il semble ne pas avoir entendu cette redondance algique dont les rimes «aille» et «ouille» ponctuent le discours des êtres qui souffrent.
"
Mais si nous réapprenons à mieux écouter nos mots, si nous parvenons à nous extraire du carcan sémantique lexical qui a emprisonné notre conscience, tout redevient audible et évident. La douleur physique et morale, dont l'empreinte phonétique a été conservée dans nos mots modernes, marque encore au fer rouge nos langues occidentales ! Et avec cette nouvelle écoute la dépouille criante de nos maux s’entend dans nos mots qui tressaillent (voire tressent «aïe» !).
Avec la flagrance de l'ironie prêtons une oreille attentive à cette résonance du risque douloureux physique ou moral dans le langage, écoutons jusqu’à l’excès caricatural cette litanie d'«aïe» et «ouille» qui a marqué de son sceau onomatopéique nos pauvres vies d'ouailles pour prendre conscience du degré de dédain ou de refoulement où l'apprentissage
Comme plusieurs de ses contemporains tel Maurice Toussaint, le Professeur de linguistique Michel Launay a consacré on oeuvre à une linguistique qui s'écarte des discours officiels en proclamant ne souhaitait rien de moins qu’une linguistique qui s’écarterait des discours oƒƒiciels en proclamant avec force ce que Lacan avait appelé dans ses Écrits : « la suprématie du signiƒiant ». Mais au lieu de remettre sur la table des négociations le débat du Cratyle(thései vs. phusei) que la linguistique moderne (à travers l’opposition : arbitraire vs. motivé) s’est ƒinalement contentée de réinterpréter, il préférait se demander quelles pouvaient être les raisons pour lesquelles les spécialistes du langage ont toujours fait la part belle au « dogme de l’arbitraire », en subordonnant — par exemple — aux cours de linguistique générale dictés par Saussure entre 1908 et 1911, l’énorme quantité de notes (en partie inédites !) que le même chercheur a consacrées aux Anagrammes de la poésie latine ou contemporaine.
3M. Launay a destiné plusieurs essais à l’analyse très minutieuse d’un certain nombre de signes puisés dans l’espagnol (ou le français) modernes ; mais il a toujours visé, au-delà des monographies, une théorie générale du langage qui — premièrement — rende compte de la totalité des énoncés que les sujets parlants sont capables de produire (en particulier : le slogan, le calembour, le mot d’esprit, la poésie…) et qui — deuxièmement — donne aux signiƒiants leur juste place dans le processus de signiƒication (ou de fabrication du sens par le système de la langue). Avec la patience et la rigueur qui doivent présider à cette sorte de travaux, il s’est efforcé de voir dans des phénomènes considérés comme « hors langue » (le lapsus ou la faute) autant de doigts pointés vers le système qui les a permis ; d’inverser le rapport séculaire en faveur de la raison au proƒit des associations inconscientes que les signiƒiants autorisent (ou suggèrent) ; de faire de la linguistique une branche de la poétique ; bref : de prendre le contrepied d’une discipline qui s’est constituée sous l’emprise de la prose scientiƒique et qui n’a pas — de son avis — atteint les objectifs qu’elle s’était proposés. En considérant les surfaces d’une langue comme ce qu’elle a de plus profond, cette linguistique nouvelle prône à tous niveaux un retournement des valeurs traditionnelles et mérite, de ce fait, d’être qualiƒiée de « subversive ».
4À notre demande, il a accepté de (ré)écrire, en 2003, un article qui porte le même titre, mais se distingue clairement du premier pour diverses raisons ; en particulier : parce qu’il prend en considération de récentes découvertes et donne à voir l’état actuel de sa pensée. S’il convient à l’évidence de le remercier de cet effort, il importe aussi de savoir gré à la revue Mélanges de la Casa de Velázquez de vouloir porter à la connaissance d’une communauté scientiƒique (celle des linguistes, des sémioticiens, des littéraires, mais aussi des lecteurs et des sujets parlants) une réflexion qui la concerne et l’interpelle puissamment, puisqu’elle met en cause une idéologie : c’est-à-dire, on l’a compris, une vision du monde et de soi-même qui se trouve ancrée dans le langage comme dans notre manière de le penser. (J.-L. P.)
La suite de ce site démontrera que le signifiant a la fonction de désigner le référent en le symbolisant. Plus précisément le signifiant est composé d'unités séquentielles littérales signifiantes inconscientes, dont l'origine est bien préexistante à des unités signifiées inconscientes qu'elles représentent et sont coexistantes à la perception sensorielle ou émotive de certaines caractéristiques du référent. Ainsi le signifiant conscient saussurien est un assemblage d'unités signifiantes inconscientes, véritables noeuds doubles du signifiant que Lacan n'aura pas su dénouer. S'il écrit que «la science dont relève l'inconscient est la linguistique», il ne peut pas s'agir de la linguistique conventionnelle saussurienne qui ne s'intéresse qu'à la partie secondaire du langage, sa partie émergée consciente. D'ailleurs Lacan énonce que la nature du langage de l'inconscient ne concerne pas le découpage de la chaîne en fonction d'un signifié, qui toujours et sans cesse se dérobe, mais en fonction des propriétés de la chaîne signifiante elle-même. Même intelligents, nous sommes bornés par le Savoir que nous avons acquis par apprentissage et dont la mémorisation conditionne notre logique de pensée. Ce savoir n'est jamais qu'un voir ça, qu'une vision pré-établie par conditionnement qui nous aveugle.
extrait du Livre
Entendre les mots qui disent les maux
auteur : docteur Christian Dufour Juin 2006
Editions du Dauphin (Paris)
La langue parlerait-elle à notre place ?
Avec
Jean-Pierre Cléro, philosophe, professeur émérite de philosophie à l’Université de Rouen
Lacan était un véritable moulin à paroles, mais ce n'est pas sa faute disait-il : « Une fois que vous êtes entré dans la roue du moulin à paroles, votre discours en dit toujours plus que ce que vous n’en dîtes ». Alors, la langue parlerait à notre place ? Qu'est-ce que cette inconscient dont Lacan a rendu la formule si célèbre en disant qu'il était structuré comme un langage ?
La vérité qu’il y a à énoncer, si vérité il y a, est là dans le message. La plupart du temps, aucune vérité n'est annoncée, pour la simple raison que le discours ne passe absolument pas à travers la chaîne signifiante, qu'il en est le pur et simple ronron de la répétition et du moulin à paroles et qu'il passe quelque part en court-circuit par ici entre bêta et bêta, et que le discours ne dit absolument rien sinon de vous signaler que je suis un animal parlant. C'est le discours commun de ces mots pour ne rien dire, grâce à quoi on s'assure, qu'on n'a pas en face de soi affaire à simplement ce que l'homme est au naturel, à savoir un bête féroce. (…) Il n'y a pas de parole possible pour la bonne raison que la parole suppose précisément l'existence d'une chaîne signifiante, ce qui est une chose dont la genèse est loin d'être simple à obtenir et suppose l'existence d'un réseau des emplois, autrement dit de l'usage d'une langue. Ce qui suppose en outre tout ce mécanisme qui fait que, quoi que vous disiez, en y pensant, ou en n'y pensant pas, quoi que vous formuliez, une fois que vous êtes entré dans la roue du moulin à paroles, votre discours en dit toujours plus que ce que vous n'en dites.
Jacques Lacan, Les Formations de l’inconscient, Séminaire VII, 6 novembre 1957
Extraits
Archive Lacan « Le sinthome », Séminaire du 11 février 1975
L’inconscient est structuré comme un langage, affirme le psychanalyste Jacques Lacan. Mais comment expliquer alors qu’il considérait la langue anglaise comme étant impropre à l’analyse ? Si l’inconscient est un langage, pourquoi ne parle-t-il pas toutes les langues ?
Avec
Jean-Pierre Cléro, philosophe, professeur émérite de philosophie à l’Université de Rouen
L'invité du jour :
Jean-Pierre Cléro, philosophe, professeur émérite de philosophie à l’Université de Rouen
à lire

Lacan, grandeur et dissidence
L’inconscient est structuré "comme" un langage :
Lacan dit que l’inconscient est structuré "comme" un langage. Cela veut dire qu’il dissimule un certain nombre de choses au sujet, par le simple fait qu’il y ait cette structure. La structure permet d’accéder à certaines idées facilement, et d'autres idées sont complètement oblitérées. Or, ce que vous pouvez dire en anglais, vous ne pouvez pas toujours le dire exactement en français. Tous les traducteurs le savent. Quelque langue que ce soit est toujours un peu en porte-à-faux avec les autres langues. On peut accéder à certaines idées par un langage, mais énormément de choses nous échappent alors que tout est sur la table, qu'on voit toutes les structures. Tout se passe comme si on ne saisissait pas toute une série de choses que d’autres schèmes pourraient dire. C’est ça qui fait que l’inconscient serait structuré "comme" un langage. Jean-Pierre Cléro
Le sujet comme étant toujours pris dans une structure :
Certes il faut distinguer la parole et la langue. Quoique Lacan parle de langage plus que de langue. Le langage étant la faculté de parler une langue. La parole et la langue sont donc relativement mêlées dans le langage, alors que Saussure s’était évertué à les décoller l’un de l’autre. On a donc le sentiment que chez Lacan, le sujet n’est pas véritablement le lieu de l’inconscient. Il dit d’ailleurs que c’est le langage qui est le milieu du sujet. C’est ce qui distingue Lacan des philosophes qui se trouvaient dans le sillage de la phénoménologie et qui pensaient qu’hors des philosophies du sujet il n’y avait point de salut. Lacan essaie de montrer que la fonction subjective et les positions diverses d’un sujet en quelques situations que ce soit, ne s’expliquent que par une structure beaucoup plus générale que ce qui peut se passer à l’intérieur du sujet ou comment il peut, lui, voir les choses. On est toujours pris dans une structure. On est autant parlé que l’on parle. Jean-Pierre Cléro
La psychanalyse, une construction entre l'analysant et l'analyste :
Peut-être est-il bon que l’analysant ait un certain nombre d’illusions, en particulier celle d’aller rechercher l’histoire de sa vie comme elle s’est réellement passée. Mais il est impossible de faire resurgir ces événements, ils n’ont plus aucun présent. Il n’y aura jamais de conformité entre le discours que l’on tient dans l’analyse et ce qu’il s’est passé. Parce que par définition, ce qu’il s’est passé, on ne le sait pas. Ni l’analysant, ni l’analyste ne le savent. Mais quelque chose se construit entre l’analysant et l’analyste au moment de l’analyse et c’est ça qui compte, c’est ce récit qui n’est ni vrai ni faux, qui se construit, avec sa solidité propre. La psychanalyse n’a pas d’autre sens. Jean-Pierre Cléro

SUITE
cliquez sur : Une motivation douloureuse

RETOUR
Cliquez sur Page d'accueil
 Bonjour. Et si Lacan veut dire que le signifiant créé le signifié, l'inconscient créé l'objet, c'est-à-dire le structure tel qu'il est vécu-perçu-représenté-pensé... Une simple intuition de "Au début était la Parole." et qu'au début tout était tohu-bohu et la Parole a tout organisé…
Bonjour. Et si Lacan veut dire que le signifiant créé le signifié, l'inconscient créé l'objet, c'est-à-dire le structure tel qu'il est vécu-perçu-représenté-pensé... Une simple intuition de "Au début était la Parole." et qu'au début tout était tohu-bohu et la Parole a tout organisé… HRéponse tardive à Alexandre
HRéponse tardive à Alexandre Si votre relation est sur le point de prendre fin ou si votre proche s’éloigne ou s’est éloigné de vous. Vous avez des problèmes familiaux ? Je peux vous aider à le ramener. Ou Parfois, c’est vous qui devez rompre avec votre partenaire juste à cause de sa possessivité, de sa nature dominatrice ou pour toute autre raison. Je peux en effectuer une pour vous, Sort fort et puissant.
Si votre relation est sur le point de prendre fin ou si votre proche s’éloigne ou s’est éloigné de vous. Vous avez des problèmes familiaux ? Je peux vous aider à le ramener. Ou Parfois, c’est vous qui devez rompre avec votre partenaire juste à cause de sa possessivité, de sa nature dominatrice ou pour toute autre raison. Je peux en effectuer une pour vous, Sort fort et puissant. J'ai trouvé un assistant divin qui est très réel, honnête et fait ce qu'il dit qu'il fera, il a fallu quelques jours pour que mon sort se révèle et les résultats sont incroyables… vous bénisse et les dieux vous gardent en sécurité et bien . J'ai récupéré mon ex avec l'aide du Grand Maître Spirituel Comlan AMANGNON. Toute ma vie, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, je me sens très heureuse et comblée d'avoir pris la bonne décision. C'est tellement réel et puissant !! Envoyez-lui un message via Whatsapp directement au +229 9778 8791. Si vous voulez un amour inconditionnel, vous devez vous donner complètement. L'amour est un engagement, pas un sentiment. Connaître la différence. Les relations exigent un engagement sérieux que la plupart n'ont pas. Le mariage est encore plus difficile et beaucoup de personnes ne sont pas capables d'assumer les responsabilités d'être loyal, fidèle, engagé et dévoué envers votre conjoint et votre vie ensemble parce que c'est votre priorité et que rien d'autre n'a d'importance. Contactez le Grand Maître Comlan AMANGNON et il résoudra tous vos problèmes de mariage ou de relation Email: contact.maitreamangnon@yahoo.com
J'ai trouvé un assistant divin qui est très réel, honnête et fait ce qu'il dit qu'il fera, il a fallu quelques jours pour que mon sort se révèle et les résultats sont incroyables… vous bénisse et les dieux vous gardent en sécurité et bien . J'ai récupéré mon ex avec l'aide du Grand Maître Spirituel Comlan AMANGNON. Toute ma vie, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, je me sens très heureuse et comblée d'avoir pris la bonne décision. C'est tellement réel et puissant !! Envoyez-lui un message via Whatsapp directement au +229 9778 8791. Si vous voulez un amour inconditionnel, vous devez vous donner complètement. L'amour est un engagement, pas un sentiment. Connaître la différence. Les relations exigent un engagement sérieux que la plupart n'ont pas. Le mariage est encore plus difficile et beaucoup de personnes ne sont pas capables d'assumer les responsabilités d'être loyal, fidèle, engagé et dévoué envers votre conjoint et votre vie ensemble parce que c'est votre priorité et que rien d'autre n'a d'importance. Contactez le Grand Maître Comlan AMANGNON et il résoudra tous vos problèmes de mariage ou de relation Email: contact.maitreamangnon@yahoo.com