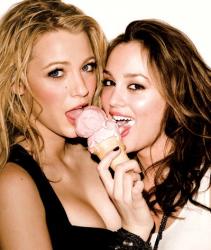De l'onomatopée au nom
Les onomatopées fournissent les briques pour construire les mots
L'onomatopée à l'origine des mots
Glouglou ! Gloups ! Glagla !
Qu'est-ce qu'une onomatopée ?
"Onomatopée" est un mot attesté à la fin du XVème siècle, emprunté en 1585 au bas latin onomatopeia, issu du grec ancien tardif onomatopoia, signifiant création (poïesis) de nom (onoma) en particulier par imitation de son. Ce mot était employé pour désigner un grand nombre de phénomènes liés à la motivation du signe linguistique qui par ses caractéistiques phonétiques ou articulatoires évoque le référent. L'onomatopée acoustique est donc une unité lexicale, créée par imitation d'un bruit naturel pour évoquer l'être ou la chose que l'on veut nommer : cocorico mime le cri du coq, crac mime le bruit d'une chose qui se brise...
"Le génie pénètre par l'onomatopée dans la nuit de la formation des langues" (Senancour, Rêverie)
"Glouglou" est une onomatopée qui mime le bruit d'un liquide qui s'écoule par saccades (dans un contenant ou d'un contenant) du fait de l'obstruction momentanée du conduit : le glouglou des flacons, des bouteilles. C'est aussi l'imitation du cri du dindon qui glougloute.
"Gloups" est employé pour mimer le bruit de la déglutition et par extension traduire l'embarras, la gène à la suite d'une erreur : "gloups, je crois que j'ai cassé votre verre".
"Glagla" exprime que l'on tremble de froid. Ce mot invariable est inséré dansl e discours pour exprimer une sensation de grand froid. Il est apparu dans le années 1936. La frontière entre interjection est onomatopée est souvent floue. Es onomatopées sont imitatives, ce sont des mimophones. Glagla put être consuféré comme l'imitation du bruit émi parun sujet qui tremble de froid, qui claque des dents en frissonnant.
Barthélémy, premier tome de la troisième série, n° 17, Journal de la Langue française et des Langues en général, novembre 1838 La Vieille Orthographe
J'ai fait depuis long-temps (personne ne s'en doute),
Sur la langue française et sur les mots anciens,
Des travaux inédits et grands comme les siens.
L'homme voulut créer une langue première.
Et marquer par le son, par l'effet de la voix,
Les objets qu'il voyait pour la première fois.
La nature elle-même, envers lui débonnaire,
Fournit les éléments de son dictionnaire,
Et l'homme intelligent, à son école instruit,
Pour nommer une chose en imita le bruit :
Il sut que l'Océan est bercé par la houle,
Que le cheval hennit, que le pigeon roucoule.
Il nomma bêlement la plainte du troupeau,
Entendit sous les joncs croasser le crapaud,
Fit, à travers les bois, siffler la froide bise,
Craquer avec fracas le chêne qui se brise,
Pour tous les animaux aux mugissements sourds,
Institua les noms de loup, de bœuf et d'ours,
Et son oreille enfin, de mille sons frappée,
Construisit tous ses mots par onomatopée.
EN COURS de CORRECTION
Saussure, lui exclut d'un revers de manche un peu trop leste le rôle des onomatopées dans la langue. Dans le Cours il est écrit "Quant aux onomatopées authentiques (celles du type glou-glou, tic-tac, etc.), non seulement elles sont peu nombreuses, mais leur choix est déjà en quelque mesure arbitraire, puisqu'elles ne sont que l'imitation approximative et déjà à demi conventionnelle de certains bruits... Sauss.1916, p.102. B. )
− P. méton. Mot ainsi formé. L'idée de rouge se fixa sur la crête de coq, puis sur le coq et enfin sur le chant du coq que rendait l'onomatopée coquelicot ou coquericot (Gourmont,Esthét. lang. fr., 1899, p.192
Les organes de la phonation
La langue
Les modulateurs tels les lèvres, la langue et le voile du palais vont transformer les sons en phonèmes afin de constituer les mots. La langue, organe le plus important du langage joue un rôle essentiel dans la production des timbres vocaliques, elle détermine le point d'articulation Même si les dents sont utiles pour prononcer certains sons, un enfant peut parler sans en avoir. Dans la langue française, les dents interviennent par exemple sur le « t » ou le « d », lorsque la langue tape contre les incisives. Sans être indispensables, les dents favorisent tout de même une meilleure articulation.
Les formes onomatopéiques se retrouvent couramment dans toutes les langues. Leur importance varie cependant d’une langue à l’autre. La présence de cette catégorie de mots “naturels” incite certains linguistes à formuler une hypothèse selon laquelle les onomatopées sont les traces d’une langue primitive qui peut expliquer l’origine du langage. Partant de cette hypothèse, la présence des formes onomatopéiques est considérée comme une preuve en faveur de la thèse naturaliste qui établit l’existence de lien naturel entre les mots et les choses. Selon l’érudit Charles de Brosses (1709-1777), l’origine du langage et la formation ultérieure des mots sont bâties sur la base de l’imitation de la nature.[5
Ce n'est pas un hasard si le français comme maintes autres langues désigne la langue qu'il parle avec le même signifiant que l'organe charnu qui joue un rôle essentiel dans l'articulation des sons de la parole.
En effet le mot, le signifiant langue évoque deux acceptions, car il désigne d'une part l'organe musculeux mobile de la cavité buccale, actif dans la déglutition, la gustation et l'élocution (sans oublier le baiser à la française, le french kiss !), et d'autre part un système abstrait d'éléments formels et combinatoires (lexique, morphologie, syntaxe) qui permet la communication interhumaine grâce à l'expression vocale de la parole ou graphique de l'écriture. Cette métonymie, répandue dans les langues du monde, a émergé au cours du temps grâce aux usages populaires spontanés, car tout le monde sait qu'il est difficle de parler et donc d'exprimer sa pensée sans une langue dans sa bouche. Les expressions qui font l'amalgame entre l'organe buccal et le système de signes sont légion et la langue française en est chargée. Les mouvements de la langue elle-même peuvent être des signes porteurs de sens. Tirer la langue à quelqu'un n'est pas qu'un mouvement organique, mais il exprime une intention de narguer ou de moquer l'autre. Avoir la langue bien longue est une métaphore qui traduit un excès de propos, l'avoir bien pendue exprime qu'on a la parole facile. Ne pas avoir la langue dans sa poche traduit un sens vif de la répartie, alors que se la mordre traduit une retenue à parler par crainte de dire des choses qu'il vaut mieux taire. Certains ont une mauvaise langue, voire une méchante de vipère. Il est possible d'avoir la langue qui fourche lorsqu'on dit un mot pour un autre, d'avoir un mot sur le bout de la langue lorsqu'on est prêt à le dire, mais qu'il nous échappe encore. Le bon sens populaire connait la dangerosité et l'imprécision des mots et conseille de tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler, de répondre à quelqu'un. On peut même donner sa langue au chat lorsqu'on renonce à deviner quelque chose.
Cette double acception du mot langue, qui relève d'une métonymie fonctionnelle, montre le lien entre les mouvements buccaux de la langue et la pensée de l'individu, exprimée par les mots de sa parole. Saussure considère la langue comme le produit de l'esprit collectf des groupes linguistiques. Pour lui l'essentiel de la langue est étranger au caractère phonique du signe linguistique. Le son n'est que l'instrument de la pensée. Pourtant un musicien qui aurait une partition sans instrument n'émettrait aucun son. Mais selon Saussure, il ne serait pas prouvé que "la fonction du langage telle qu'elle se manifeste quand nous parlons soit entièrement naturelle, c'est-à-dire que notre appareil vocal soit fait pour parler comme nos jambes pour marcher". Il est certain que l'organe de la parole a emprunté celui de l'alimentation mais les cordes vocales sont au cœur de la diversité et de la richesse des performances vocales humaines. Leur longueur, leur épaisseur, leur souplesse ainsi que leur mode de vibration varient d'un individu à l'autre, expliquant la singularité de chaque timbre de voix.13
Appareil phonatoire humain
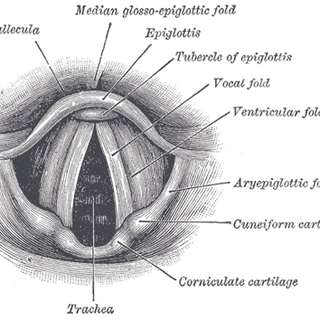
L'appareil P e répertoire de la voix humaine est un des plus vastes du règne animal.
David Reby est professeur d'éthologie à l'Université Jean Monnet et membre de l' Institut Universitaire de France : « La production des vocalisations chez les vertébrés s'explique dans le cadre d'une théorie qui s'appelle la théorie source-filtre de la production de la voix ou de la parole. L'idée, c'est que les sons vocaux sont issus d'un phénomène en deux étapes. Le premier niveau, c'est au niveau de la source, c'est au niveau du larynx, où par vibration des cordes vocales, on crée un son source qui va avoir une intonation, qui va avoir une hauteur, mais qui ne sera pas articulée. Ensuite, ce son va voyager dans les cavités, ce qu'on appelle les cavités supralaryngées, au-dessus du larynx, c'est-à-dire le pharynx, la cavité orale et la cavité nasale. A ce stade-là, lorsqu'on parle par exemple, par les mouvements de la langue, des lèvres, des articulateurs, on va filtrer ce son, on va changer les caractéristiques de résonance de ces cavités supralaryngées pour produire des voyelles et des consonnes. La production de la voix se fait en deux étapes, la source au niveau du larynx et le filtre au niveau de la bouche et du pharynx essentiellement. »
Chez les animaux, il y a beaucoup de modulation dans le larynx, à la source donc. Par exemple, les chimpanzés font des cris très variés, parfois ils sont même capables d’en faire deux en même temps, on parle de biphonation. En revanche, il y a peu de variation sur le filtre - en résumé ils ne bougent pas les lèvres. Et chez l'humain c'est l'inverse, la source ne varie pas, on parle avec un même sou
Saussure selon son Cours affirme que la langue ne serait qu'une convention et que la nature du signe dont il est convenu est indifférent. La langue ne serait que le produit que l'individu enregistre passivement, elle apparait comme l'héritage de la période précédente, elle ne serait que la partie sociale du langage, extérieur à l'individu qui lui seul ne peut ni la créer, ni la modifier, elle ne constituerait qu'un système de signes, qu'un dépôt d'images acoustiques. Les signes seraient immotivés, sans attache avec la réalité. Quant au lien unissant le signifiant et le signifié, il serait totalement arbitraire sans motivation, tout comme leur ensemble qui constitue le signe serait sans rapport naturel avec la réalité du référent. Saussure instaure le règne total de l'arbitraire comme principe de sa linguistique.
Il signale seulement deux objections concernant l'arbitraire: "On pourrait s'appuyer sur les onomatopées pour dire que le choix du signifiant n'est pas toujours arbitraire. Mais elles ne sont jamais des éléments organiques d'un système linguistique. Leur nombre est d'ailleurs bien moins grand qu'on le croit. Des mots comme fouet ou glas peuvent frapper certaines oreilles par un sonorité suggestive; mais si l'on remonte à leur forme latine (fouet dérivé de fagus, hêtre et glas du latin classicum, sonnerie de trompettes), la qualité de leurs sons actuels ou plutôt celle qu'on leur attribue, est un résultat fortuit de l'évolution phonétique". L'opinion de Saussure est subjective et critiquable : le son <cl> de classicum ou classum est plus résonnant que le <gl> de glas : claironner, klaxonner, clarinette, clavecin, éclat (sonore), claquement, clac, etc. Fouet et fagus sont initiés par la consonne fricative f dont l'articulation est produite en contractant l'air à travers une voie étroite au point d'articulation causant de la turbulence. Fouet dérive de l'ancien français fou signifiant petite baguette de hêtre. Le fouet et la baguette flexible de hêtre ont la propriété d'émettre en action un sifflement par la turbulence de l'air.
Le point de vue de Saussure est étonnant car il sait parfaitement que tout signifiant actuel peut renvoyer à un signifiant ancien phonétiquement différent : le mot langue a évolué à partir du mot latin lingua, un terme désignant l'organe anatomique et le système d'expression commun à un groupe, une langue que l'on pouvait donner au chat chez les Latins, un mot issu du bas latin cattus suite à une règle d'évolution phonétique. Si cattus et chat renvoient au même référent, comme arbor et arbre, cette évolution phonétique n'est-elle pas responsable de la désignation du référent par des caractéristiques différentes... si ces signifiants sont motivés ? Saussure ne se pose pas la question, car sa théorie sur la langue repose d'emblée sur l'axiome de l'arbitraire de ses signes, un énoncé non démontré qu'il imagine évident et universel.
Saussure évoque la nécessité de l’étude diachronique pour détecter la motivation des signes en opposant les onomatopées 5 On peut également trouver iconic, echoic, onomatopoeic, car les qualificatifs sont nombreux. 47 authentiques, déjà évoquées, aux mots comme ‘fouet’ ou ‘glas’, [qui] frappe[nt] certaines oreilles par une sonorité suggestive (CLG : 102). Ces derniers (fouet, glas) ne sont pas des onomatopées authentiques précisément en ce que leur origine étymologique, leur forme latine, ne reflète pas cette motivation perçue par le locuteur : en effet, le caractère suggestif de leurs sonorités n’est pas présent dès leur origine. Ce caractère suggestif n’est que le résultat fortuit de [leur] évolution phonétique (ibid., 102). En d’autres termes, une onomatopée authentique, motivée en langue, devrait dès son origine présenter un caractère motivé
. Interjections et onomatopées échappent à l’analyse linguistique à tel point que dès à présent un problème de désignation se pose. Comment les désigner dans leur ensemble ? P
aussure reconnait qu'avec l'onomatopée, il existe un lien direct entre signifié et signifiant. Pourtant, ces mots peuvent être non motivés (sans ressemblance), comme Ouah (en français) et Bow wow (en anglais) pour l'aboiement d'un chien
l'onomatopée est un phénomène marginal dans l'étude du langage et ne mérite pas une attention particulière en linguistique, l'étude du langage proprement dit .
Cependant, la linguistique ne peut se dispenser de les décrire, car s’ils occupent une place souvent qualifiée de marginale dans le système de la langue, on ne peut qu’être frappé de leur omniprésence dans le discours
L'onomatopée (mot féminin issu du grec ancien ὀνοματοποιΐα, [ὀνομα(το) (mot) et poiía (fabrication, soit « création de mots ») est un mot écrit utilisé pour transcrire un son non articulé. Par exemple, les expressions « cui-cui » et « piou-piou » sont les interjections désignant le cri de l'oisillon, « crac » l'onomatopée évoquant le bruit d'une branche que l'on rompt ou d'un arbre qui tombe au sol, « plaf » et « plouf » correspondent au bruit d'un plongeon, "paf" correspond au bruit d'un claquement (sur une joue par exempl bling bing pinpon, vroum vrour néogénése ome-atopéiétique
L'arbitraire du signe est combattu par quelques linguistes qui admettent un certain degré de motivation des mots. Ainsi P. Guiraud dans "Structures étymologiques du lexique français" (1967) confirme l'existence de la motivation de mots onomatopéiques de type acoustique où existe une analogie entre sons signifiés et sons signifiants tels glouglou, flic flac, clac et claquer, boum... qui peut s'étendre par métaphore aux couleurs ou idées assimilées à des bruits, tel l'éclat de la couleur ou la gravité de la maladie. Ce sont des mimophones.
Il relève aussi l'existence d'onomatopées articulatoires quand le mouvement des organes de la parole présente une analogie avec le mouvement signifié : par exemple le français glisser et l'anglais to glide portent ce son gl qui s'effectue "la langue tendue à plat avec une aperture resserrée et un souffle expiratoire chassé à travers le canal latéral le long duquel il glisse". La langue qui glisse mime le schème de glissade. Il est probable que ce mouvement lingual se réalise grâce à des réseaux neuronaux, dont les ancêtres commandaient les gestes de glissement de doigts ou du corps tout entier.
u Japon, il existe un nombre incalculable d'onomatopées qui, comme en anglais, ont aussi bien des fonctions verbales que nominale Si le français utilise les onomatopées essentiellement comme phononymes, d'autres langues, comme le japonais, utilisent des images sonores comme phénonymes (mots mimétiques représentant des phénomènes non verbaux : ex. ジロジロ(と)[見る], jirojiro (to) [miru], signifiant regarder intensément) ou comme psychonymes (mots mimétiques représentant des états psychiques) : ex. グズグズ[する], guzu guzu [suru], signifiant être prostré, littéralement faire gouzou gouzou). Les onomatopées sont néanmoins considérées comme des mots à part entière par la plupart des académies linguistiques.
aux niveaux neurologique et acoustique, certaines études semblent révéler des caractéristiques particulières aux onomatopées et aux interjections. Par exemple, les travaux d’Hashimoto (2006) montrent grâce à l’IRM que des stimuli acoustiques onomatopéiques activent à la fois les régions cérébrales activées lors de l’écoute des cris des animaux dont les onomatopées sont des imitations et les aires cérébrales activées à l’écoute des noms communs désignant ces mêmes animaux. Hashimoto décrit donc les onomatopées comme des ponts (bridges, dans le texte) entre la perception du langage humain et la perception des bruits de l’environnemen
Alors que les théories de l'onomatopée affirmant à la suite de Leibniz que les onomatopées sont à l'origine du langage ont été réfutées depuis par Max Müller, Otto Jespersen ou Chomsky, l'onomatopée, comme son étymologie l'indique, reste un moyen de formation de mots important dans les différentes langues : de nombreux mots des lexiques des différents idiomes sont des dérivés d'onomatopées.
La bande dessinée fait un usage fréquent d'onomatopées pour illustrer les actions sonores non parlées. C'est en particulier fréquent dans les comic strips, auxquels Serge Gainsbourg rend hommage en 1968 en chantant Comic Strip, que Brigitte Bardot ponctue d'onomatopées
Claude Francois le jouet extrordinaire n jouet extraordinaire
Avec de gros yeux verts
Je l'ai pris dans mes bras mais quand
Je l'ai posé par terre
Il faisait zip quand il roulait
Bap quand il tournait
Brrr quand il marchait
Dans le grenier j'ai retrouvé
Ce jouet extraordinaire
J'ai appelé mon p'tit garçon
Et le lui ai offert
Il était vieux et tout rouillé
Mais quand on l'a posé par terre
Il faisait toujours zip
Quand il roulait bap
Quand il tournait brrr
Quand il marchait
Je ne sais pas ce que c'était
Et je crois que je n'le saurai jamais
Je ne sais pas ce que c'était
Et je crois que je n'le saurai jamais
Jacques Dutronc Les Plays boys Moi j'ai un piège à fille, un piège tabou
Un joujou extra qui fait "crac-boum-hu"
Les filles en tombent à mes genoux
Serge Gainsbours Comic strip
Gainsbourg propose cette année-là une chanson totalement innovante, truffée d'onomatopées. L'invitation est sans ambiguïté :
Viens petite fille dans mon comic strip
Viens faire des bulles, viens faire des WIP !
Des CLIP ! CRAP ! des BANG ! des VLOP et des ZIP !
SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZZZZ !
olette s, d’onomatopées : « heu, heu », « Ploc ! ploc ! », « Tsk, tsk » ou de pseudo‐onomatopées comme le « Kekekekekecekça ? » des grenouilles. Ces marques langagières de l’enfance, (l'enfant est appelé « bébé »,) composées de bruits et de sonorités diverses, ainsi que les nombreuses didascalies
On trouve de fait au Japon, « pays des onomatopées [5] », des dictionnaires qui les compilent et les explicitent ; les mangas et la littérature en sont truffés où elles « offrent une « bande son » riche d’une puissante force d’évocation » (Nouhet-Roseman 2010, p. 168) ; toute discussion est constamment ponctuée de mots phatiques qui permettent de garder le contact en sonorisant l’état d’écoute et d’attention (« Mmmh », « Etto », « Sokka », « ne », etc.). Le langage courant y a recours dans la description des phénomènes, c’est-à-dire des événements qui engagent significativement la subjectivité du locuteur, quel que soit le registre. Il pourra s’agir, par exemple, d’un certain type de frottement d’étoffe, d’un bruit qui sonne singulièrement, d’une sensation de peau qui engage la caresse, d’une façon particulière de regarder, de l’éveil d’un sentiment nouveau ou inattendu. Car l’onomatopée signe tout ce qui interpelle l’attention, que cela fasse dresser l’oreille, la vue, les sensations du cœur (kokoro), les narines, la sensibilité tactile ou les papilles. Tout ce qui arrive – que ce soit de l’ordre de la sensation, du sentiment, de l’émotion ou de la perception – semble avoir, en japonais, une sonorité. Pika pika, par exemple, traduit quelque chose d’étincelant, de scintillant comme le pavillon d’or de Kyoto. Kiiii évoque un bruit strident, qui pénètre l’oreille. Le bruit d’un roulement peut faire koro koro, goro goro, korori, kororin, selon la consistance et la sonorité du matériau (par exemple, karan karan est le bruit que fait un objet métallique). Gusugusu est le bruit de reniflement d’une personne enrhumée, kun kun celui d’une personne qui hume un parfum. Bura bura sonorise l’état d’esprit dans lequel se trouve quelqu’un qui flâne avec contentement, mais muka muka exprime la colère réprimée et difficilement contenue, tandis que doki doki correspond à l’état de trac d’un acteur qui entre en scène ou d’un footballeur sur le point de tirer un pénalty. Jiro jiro est le regard sans gêne, maji maji le regard fixe et captivé, et shige shige le regard scrutateur, voire inquisiteur. Boton est le bruit que fait une canette de bière quand elle tombe dans le réceptacle d’un distributeur de boissons. Tsuru tsuru est la sensation de peau que l’on éprouve au sortir du bain dans une onsen (source thermale). Zawazawa est le bruissement de la ville associé à un sentiment d’angoisse. Don est une forte détonation, de celles que font les « feux d’artifices » (hanabi) ou les explosions de bouteilles de gaz lors d’un incendie. La combinaison de Don et de Pika (quelque chose d’étincelant) forme Pikadon, le son au moyen duquel on désigne l’explosion des bombes atomiques Little boy et Fat Man sur Hiroshima et Nagasaki.
es créations onomatopéiques sont monnaie courante. Les Japonais les classent en trois sortes, les giongo sont construites à partir des sons du corps et de son environnement (bochan pour dire Plouf !, gata gata pour le son d’un tremblement de terre) ; les giseigo traduisent les voix (wan wan pour un aboiement, kyaa pour un cri féminin) ; les gitaïgo, « mots imitant l’état » rendent compte d’attitudes, de sensations et de qualités comme peut le faire un Bof ! en français. Toutes suivent une logique qui permet à l’interlocuteur d’en saisir le sens au long d’un rhizome similaire à celui que dessinent les racines étymologiques de certains de nos propres néologismes. En remarquant qu’au Japon les onomatopées ne sont devenues si fréquentes qu’à partir du XVIe siècle, Augustin Berque défend l’idée que cette « verbalisation du perçu » est le signe d’une « option culturelle » qui valorise la perception immédiate. Son usage dans une langue donnée pourrait même constituer « un indice du rapport que les individus parlant cette langue entretiennent avec la réalité » (Berque 1986, p. 35-36). Ainsi, « la propension du japona
’onomatopée permet en effet de faire le pont entre l’imprédicable (l’environnement) et le sonore (une nature), entre le fait brut et le dicible (un monde)is à multiplier les onomatopées, donc à réduire le degré de verbalisation, est un signe parmi d’autres que la culture japonaise tend à abstraire le moins possible le sujet de son milieu » (op. cit. p. 38).
:
L’arbitraire du signe, qui permet d’exprimer une idée (une « signification », dira le linguiste) sans référence au contexte d’élocution (un signifiant) ne caractérise pas les interjections. Ces dernières, bien au contraire, « prétendent exprimer une perception uniquement sensible [et] non intellectuelle » (Labrune 1987, p. 286). Elles sont motivées par ce qui entoure les locuteurs, et ne participent au langage que dans la mesure où elles sont « performées » dans une situation singulière qui soulève un état d’être inattendu. D’une manière générale, elles traduisent la relation du locuteur à ce qui lui arrive (« Ah ! Mon Dieu ! ») ou à ce qu’il énonce (« Il prit la porte, hélas ! »). Autrement dit, les interjections et onomatopées introduisent une dimension concrète, quelque chose qui ne peut être abstrait de ce qu’est en train de vivre le sujet locuteur. Les interjections signalent un état particulier du sujet, où le langage ne va plus de soi, où le dicible fait défaut pour traduire ce qui arrive alors même que c’est précisément ce défaut et cet écart qui importent. Elles mettent l’accent sur un désordre qui touche à la motivation langagière, plus qu’à un motif (un signifié ou un signifiant) que le locuteur se sent alors incapable de traduire dans le cadre d’une logique grammaticale, ou de qualifier au moyen des mots et concepts de son vocable.
Saussure devance le contre-argument qui pourrait lui être opposé : l’existence des onomatopées et des exclamations (ces dernières correspondent à ce que nous appelons dans cette thèse des interjections primaires et secondaires). Aucune ne peut selon Saussure réfuter le principe d’arbitraire du signe, puisqu’elles ne sont que d’importance secondaire, peu nombreuses et à demi conventionnelles. Plus précisément, au sein du paragraphe consacré aux onomatopées, Saussure distingue les onomatopées authentiques de certains mots pouvant être interprétés comme onomatopéiques. Les onomatopées authentiques (glou-glou, tic-tac) contiennent bien une part de motivation, mais une part seulement, tout d’abord parce que différentes langues utilisent différentes onomatopées, et ensuite parce qu’elles sont plus ou moins entraînées dans l’évolution phonétique, morphologique, etc. que subissent les autres mots, ibid. : 102). Ainsi, seule une partie du signifiant des onomatopées authentiques est motivée. Ce sont ces onomatopées qui nous occuperont principalement dans cette thèse. Enfin, l’opposition entre motivation absolue et motivation relative : le terme de motivation apparaît pour la première fois dans le CLG non pas dans le paragraphe consacré aux onomatopées, mais beaucoup plus loin, dans la deuxième partie, linguistique synchronique, dans le chapitre consacré aux mécanismes de la langue. L’arbitraire absolu et relatif s’opposent naturellement à la motivation absolue et relative. L
Les formes onomatopéiques se retrouvent couramment dans toutes les langues. Leur importance varie cependant d’une langue à l’autre. La présence de cette catégorie de mots “naturels” incite certains linguistes à formuler une hypothèse selon laquelle les onomatopées sont les traces d’une langue primitive qui peut expliquer l’origine du langage. Partant de cette hypothèse, la présence des formes onomatopéiques est considérée comme une preuve en faveur de la thèse naturaliste qui établit l’existence de lien naturel entre les mots et les choses. Selon l’érudit Charles de Brosses (1709-1777), l’origine du langage et la formation ultérieure des mots sont bâties sur la base de l’imitation de la nature.[5
Dans un but opposé, Ferdinand de Saussure simplifie le problème en les excluant de la langue : « On pourrait s’appuyer sur les onomatopées pour dire que le choix du signifiant n’est pas toujours arbitraire. Mais elles ne sont jamais des éléments organiques d’un système linguistique ».[7] Il conteste aussi leur symbolique puisque les onomatopées comme les interjections varient selon les langues. Le cas particulier des onomatopées illustre les paliers successifs qui mènent au langage. Roman Jakobson donne des exemples, dans des onomatopées d’enfants, d’emplois de sons qui ne sont pas encore acquis en tant que phonèmes.[8] L’enfant utilise facilement divers sons pour imiter, il est à son aise lors d’une motivation directe, mais la difficulté de l’acquisition du langage réside dans la motivation indirecte, dans la mise en place du système organisé de la hiérarchie phonématique. Les onomatopées associent un objet à une unique syllabe répétée. Nous sommes à un stade primaire d’analyse. Cependant pour Roman Jakobson, « c’est plutôt à la valeur expressive de l’exceptionnel qu’à l’imitation acoustique fidèle que serait dû l’emploi chez l’enfant de voyelles palatales arrondies dans ses mots onomatopéiques, alors que dans le reste du vocabulaire il continue à les remplacer par des voyelles non arrondies ou vélaires ».[9]Selon le linguiste, l’enfant emploierait des sons non inclus dans son système phonématique pour leur valeur exceptionnelle. Ce qui est déjà une forme de motivation.
Ainsi selon la linguistique saussuriene et de ses disciples "l'origine du langage n'a pas d'importance, ce n'est pas une question à poser" !
Aisi
Pour ébaucher une nouvelle écoute des mots, il faut approfondir ce glissement lingual et linguistique. L'étymologie de glisser peut nous fournir une aide précieuse. Le mot glisser est entré dans la langue française par les Francs qui firent plusieurs incursions dans l'Empire romain. Au VI ème siècle les descendants de Clovis établirent leur suprématie sur les autres peuples germaniques, puis sur la Gaule romanisée qui finit par adopter leur nom et devenir la France. C'est à partir du francique glidan que s'est formé le verbe gliier en ancien français, mutant en glicier en 1190 sans doute sous l'influence de glacier, puis "glisser" apparu en 1165 dérivant du latin glaciare et du bas latin glace.
A la multiplicité des signifiants qui se sont succédés dans le temps pour le signifié glisser, est opposée la constante du groupe phonémique ou littéral gl. Si le signe linguistique conscient saussurien se définit par sa mutabilité diachronique, c'est-à-dire ses changements fréquents au cours de l'évolution de la langue comme en témoignent les descendants évolutifs de glisser, il faut d'emblée souligner que ces séquences sonores ou littérales motivées ont deux caractéristiques, d'une part une remarquable stabilité diachronique et d'autre part une nature inconsciente, puisque jusqu'alors ils sont ignorés de tous, ce qui - vous en conviendrez - est la preuve irréfutable de leur caractère inconscient.
Dans la page précédente sur le grondement des mots de la grippe, il semble que le doublet gr glisse linguistiquement en gl lors de la phase de liquéfaction/liquidation de la grippe, comme si le passage du r au l permettait de liquider le mauvais r du grippé !
Peut-on en conclure que le groupe phonémique gl porte à lui seul le sens de glissement ?
Pour l'établir il est nécessaire d'étudier d'autres signifiants du lexique français conscients dans lesquels gl s'est glissé. A titre comparatif si l'on compare le matériau signifiant des mots français glace, allemand Eis et anglais ice avec le verbe glisser, on se rend compte que glisser a en commun avec Eis et ice le couple de phonèmes is, qui est en rapport avec une surface, que l'on retrouve en français dans glisser, la glace se développant (es) en surface (des eaux) pour les Allemands et réalisant un obstacle (ic) glissant pour les Anglais.
Mais pour tirer son épingle du jeu des signifiants, il faut élargir la recherche à d'autres mots pris au hasard tels: épingle, agglomération, glace, glaire, angle, règle, glaive, gluant, sanglot, ongle, aigle, glousser; on se rend alors vite compte que la notion de glissement ne peut être associée qu'à glace et éventuemment à glaire et gluant, évocateurs de matière visqueuse qui peuvent faire glisser.
Les tois onomatopées glups, glouglou et glagla sont également étrangères à ce concept de glissement. La première glups est une imitation du bruit de la déglutition humaine, glouglou l'imitation d'une bouteille qui se vide et glagla l'expression de la sensation d'un froid intense.
Les caractéristiques du référent pénètrent le cerveau par l'intermédiaire des organes sensoriels qui constituent une sorte de clavier permettant d'adresser des messages informatifs multimodaux: vision, audition, olfaction, tact, goût. Le langage humain ne se transmet que par l'audition et secondairement par la vision lors de la lecture du signifiant graphique correspondant. Les onomatopées ne peuvent être qu'essentiellement de type imitation sonore, car une odeur, un goût, un toucher, une vision, une sensation thermique ne sont pas des bruits que l'on peut reproduire. Cependant il est possible de les transcrire vocalement soit parce qu'elles sont associées à un bruit tel clac qui relie le retentissement et la vision d'un objet qui se ferme comme le claquement d'une porte. Pour les odeurs et le goût, la langue est obligée de faire des comparaisons dans le registre visuel ou sonore pour tenter de transmettre cette perception olfactive, tactile ou gustative : une odeur vanillée, un contact rugueux, un goût sucré.
Pour l'onomatopée gla-gla qui traduit la sensation de froid (tact thermique), nul doute qu'il faille en chercher l'origine dans le signifiant glace (eau) qui nous refroidit, nous glace. La sensation de froid est ainsi reliée à un référent connu qui l'engendre. Ainsi gl est accessoirement associé à cette sensation de froid et pour cette sensation peut être aussi rangé dans les "esthésièmes".
Mais quel est vraiment le sens caché du couple consonnantique gl ? Si nous examinons la douzaine de mots pris au hasard, il est possible après réflexion de déceler deux sens inconscients issu du même mot conscient, soit celui de fondre, fusion soit celui de fondre sur.
Un signifié inconscient fondre
En effet la glace fond, c'est évident, et la glace (miroir) réalise la fusion de l'objet et de son image, qui se confondent (le stade du miroir pour l'enfant permet la prise de conscience de l'identité par cette image dont les lignes se fondent, se confondent avec l'image du corps réel). On fond en sanglots, on doit se fondre à la règle. L'agglomération est le résultat d'une fusion d'objets (conglomérat, global, englober et sans doute engloutir). L'épingle, comme la sangle servent à unir, à fusionner deux objets séparés, de même la glu. Le gl d'igloo est motivé par la glace qui le construit et la fusion des blocs de sa paroi. La glycine fusionne avec son support. L'angle est réalisé par l'intersection de deux lignes qui finissent par fusionner en un point, alors que la confusion des lignes et des couleurs (le fondu, fondu-enchaîné) résulte d'un aveuglement, d'un flou visuel (bigleux, glaucome) bien glauque, source d'imbroglio.
Le contact de ce qui fond, se liquéfie, fond dans la bouche est la source de mots qui prennent le gl de glace, tels glaire, glaviot, gluant, et s'étend par généralisation tactile aux éléments visqueux : glaires, voire gland, et glucide, glycine (sucre), gluten, gluau, seigle, glaise. La viscosité sanguine n'échappe pas à ce marquage: règles, sanglant ou ensanglanté, témoignant d'une effusion de sang, de globules rouges, que l'on peut corriger par transfusion.
La gloire et celle du Christ et des Saints (auréole lumineuse) est certainement liée à la diffusion, une diffusion de lumière, mais aussi avec G majuscule une diffusion de La Langue (G) comme dans le mot Graal.
La présence de gl dans églantier est plus difficile à comprendre, peut-être est-ce dû à sa remarquable capacité à fusionner par bouturage avec toute espèce de rosiers ou à s'accrocher aux vêtements pas ses épines ? Le sigle est une unité lexicale qui fusionne, agglomère les initiales des mots qui le composent.
L'aigle qui fond chaque jour sur Prométhée
Le concept de fondre sur est inscrit par la médiation de ce couple gl dans aigle (qui fond sur sa proie) ou dans sanglier (qui fond sur son agresseur). Le glaive du gladiateur, telle l'épée de Damoclès, fond sur la victime. L'ongle s'orne de gl car maints animaux tels les rapaces s'en servent pour fondre sur (ils n'ont pas bec et ongles pour rien!). En outre la matière kératinisée de l'ongle fond à la chaleur et les médecins utilisent cette propriété pour le percer avec un trombone rougi afin d'évacuer l'hématome sous-unguéal. Le nom Angles est sans doute lié au fait que le peuple "barbare"des Angles fondait sur ses ennemis lors de ses invasions nombreuses pour coloniser ce qui est devenu l'Angleterre.
Ce double sens de fondre représenté par le doublet gl permet d'expliquer les homophonies et peut expliquer le passage d'un concept à l'autre surtout dans le domaine de l'imaginaire: ainsi le gl qui fond sur de l'aigle peut être remplacé par le gl de fusion / union. L'aigle qui réunit les deux composants (conscient et inconscient) était un symbole de leur réunion dans l'hermaphrodite alchimique et symbolise la création d'un nouveau centre de la personnalité, que Jung nomme le Soi.
Le bruit de glougloutement de la bouteille a été comparé à celui de la déglutition d'un liquide: glouglou, surtout lorsqu'on l'engloutit vite. Le glougloutement du dindon et le gloussement de la poule sont d'origine onomatopéique imitative.
Si le terme Google est dérivé consciemment de gogol, inconsciemment leurs auteurs y ont clairement indiqué leur désir inconscient d'une part d'une fusion des langues (gl- G) et d'autre part d'une rapidité pour que le moteur de recherche fonde sur les mots clés recherchés.
gl = glisser/fondre, fondre sur, schèmes dynamiques auxquels peut parfois s'accrocher la sensation de froid.
Liste d’onomatopées et le bruit, cri ou sentiment exprimé.
Onomatopée Bruit, cri ou sentiment exprimé
ah sentiment vif, insistance ou renforcement; marque la surprise, la perplexité, retranscrit le rire
aïe (répété plusieurs fois) douleur et, par extension, surprise désagréable, ennui
areu areu premiers sons du langage que le bébé émet en signe de bien-être
atchoum
En anglais : achoo éternuement
badaboum chute suivie de roulement
bang explosion violente
bang
En anglais : pop éclatement d’un ballon
bang (pistolet); pan (pistolet); boum (canon); ra-ta-ta-ta (mitraillette)
En anglais : bang, blam, boom, kaboom ou pow tir de canon, de mitraillette ou de pistolet
bè; bê
En anglais : bah bêlement (de la chèvre, du mouton)
blablabla; blabla verbiage
bof mépris, lassitude, indifférence
boum quelque chose qui cogne, tombe, explose (boum : tir de canon)
broum ronflement et trépidation d’un moteur
bzzz vol des insectes (abeilles, moustiques)
chut murmure (se dit pour demander le silence)
clac bruit sec, claquement
coac coac; coa, coa
En anglais : ribbit ribbit cri de la grenouille
cocorico
En anglais : cock-a-doodle-doo cri du coq
coin-coin (invariable)
En anglais : quack quack cri du canard
cot cot gloussement, caquètement de la poule
crac bruit sec (choc, rupture), évènement brusque
croâ (souvent répété)
En anglais : caw caw cri du corbeau
cuicui; cui-cui; piou piou (poussin), cot cot (poule)
(familiers)
Au pluriel : des cuicuis, des cui-cui
En anglais : chirp chirp, tweet tweet pépiement d’oiseau
ding tintement, coup de sonnette
drelin (vieilli) bruit d’une clochette, d’une sonnette (on emploie maintenant dring ou ding)
dring
En anglais (sonnerie de téléphone) : ring ring, ring a ling, ring ding, ding dong, ding ding bruit d’une sonnette (électrique), d’une sonnette de téléphone
euh marque le doute, l’hésitation, l’embarras, la recherche d’un mot
glouglou (employé seulement comme nom, pas comme interjection)
bruit que fait un liquide qui coule dans un conduit, hors d’un récipient
cri du dindon, de la dinde
groin groin
En anglais : oink oink cri du cochon ou du sanglier
grrr grondement du chien; exprime l’agressivité, la hargne
ha douleur, surprise (agréable ou non), rire (souvent répété)
ha ha; hi hi; ho ho; hé hé (ricanement)
En anglais : hahaha, heh heh, hohoho, (tee-) heehee éclats de rire
hé; eh sert à interpeler, à appeler, à attirer l’attention
hi (souvent répété) rires ou parfois pleurs
meuh meuglement de la vache
miam; miam-miam
(familier)
En anglais : om nom nom, yum, yum-yum ou mmmm plaisir de manger
miaou
Se met au pluriel : des miaous.
En anglais : meow, miaow ou mew cri du chat
oh marque la surprise ou l’admiration, renforce l’expression d’un sentiment
ouah; ouaf-ouaf; wouf
(généralement répétés); grr (grognement)
En anglais : woof, arf, bow wow, bark, werf, ruff (généralement répétés) aboiement de chien
ouah; waouh admiration, joie, jubilation
ouch; aïe; ouille (canadianisme) douleur
ouf soulagement
ouille (souvent répété; régionalisme : ouch) exprime la douleur, la surprise et le mécontentement
ouin bruit de pleur, de sanglot
oups exprime la surprise face à une bêtise, une gaffe, un raté
paf bruit de chute, de coup
pff; pfft; pfut… exprime l’indifférence, le mépris
pin-pon
En anglais : wee woo, nee nar, nee naw bruit des avertisseurs à deux tons des voitures de pompiers
plic; plic ploc
En anglais : drup drup, drip drop, plink plonk bruit d’une goutte d’eau qui tombe
plouf; ploc; floc
En anglais : splash bruit de chute dans l’eau (floc : bruit d’un plongeon)
prout
(enfantin) bruit de pet
pschitt; pschit; pscht bruit d’un liquide qui fuse, qui jaillit, comme du champagne
psitt; psst
(familier) bref sifflement qui sert à appeler, à attirer l’attention
ronron
(familier)
En anglais : purr (ronronnement) ronflement sourd et continu, ronronnement du chat
smack
En anglais : mwah, smooch, smack baiser sonore
snif bruit de reniflement, symbolisant la tristesse
tchou tchouu; tagadam; tougoudoum (bruit des roues sur les rails)
En anglais : choo choo, whoo whoo, whoot whoot bruit du train
tic-tac; tictac (nouvelle orthographe)
Au pluriel : des tic-tac ou des tictacs
En anglais : tick tock bruit d’une horloge ou d’un autre mécanisme semblable
toc; toc-toc
(souvent répété)
En anglais : knock knock (bruit lorsqu’on frappe à la porte)
bruit, heurt
bruit lorsqu’on frappe à la porte
toc-toc; boum-boum
En anglais : thump thump, lub-dub, bum-bump battement de cœur
tsoin-tsoin; tsointsoin (nouvelle orthographe)
Au pluriel : des tsoin-tsoin, des tsointsoins imite de façon comique un bruit d’instrument à la fin d’un couplet
vlan bruit fort et sec
vouh; wouuuh
En anglais : swish (brise légère), whoosh (vent fort) bruit du vent
vroum bruit d’un moteur qui accélère
zzzz… bruit continu qui vibre légèrement, comme un bourdonnement d’insecte, un ronflement, le bruit d’un coup de fouet, etc.
Michaël Grégoire Correspondances corps - corpus : recherche de symptômes linguistiques des pathologies1
Expérience multimodale et onomatopée. Proposition d’approche par le niveau submorphologique Résumé A partir d’une exploration en synchronie et en diachronie de plusieurs vocables appartenant aux paradigmes submorphologiques en KR et en GR en français et en espagnol, nous cherchons à démontrer dans cet article le caractère multimodal de l’émergence de l’onomatopée. L’onomatopée est alors présentée comme l’extraction de la dimension sonore de l’environnement appréhendé in situ de manière plurisensorielle. Cela nous amènera à postuler l’existence d’iconicités relevant potentiellement d’autres modalités corporelles, notamment visuelle selon le même schéma cognitif d’émergence que celui de l’onomatopée, tant en synchronie qu’en diachronie, soit une sorte d’« onomatopée visuelle ». Les premières conclusions confirment pour partie celles de travaux appliquant ce type de mimétisme visuel exclusivement en synchronie comme ceux de Georges Bohas (2016, 2021) pour l’arabe ou entrent en résonnance avec certaines déductions de Dennis Philps (2006a,b ; 2008) pour l’anglais. 1. Introduction La définition de l’onomatopée donnée par le CNRTL est la suivante : A. Création de mots par imitation de sons évoquant l'être ou la chose que l'on veut nommer. B. − P. méton. Mot ainsi formé. C. − P. ext. Cri, son, groupement de sons, accompagnant habituellement certains gestes ou exprimant une sensation, certains sentiments, et grammaticalement proches de l'interjection. (CNRTL, s.v.) Du grec onomatopeia « création de mots », plus spécifiquement par imitation de sons, l’onomatopée constitue la reproduction d’une expérience auditive perçue -et donc construitepar le prisme de sa propre langue-culture et de son expérience langagière et non langagière. Il y est précisé par ailleurs que l’onomatopée décrivait initialement en grec la création lexicale au sens large avant qu’elle ne renvoie par antonomase à une imitation ne reposant que sur la dimension acoustique du langage. Notre propos ici consiste à resituer l’onomatopée dans son contexte d’émergence au sein des autres modalités dans le rapport corps-environnement. Il s’agira d’analyser certains cas d’emplois de vocables d’origine onomatopéique et les modalités d’émergence d’expériences convoquant d’autres motricités (notamment visuelle) dans des vocables présentant une analogie de forme. Nous avons fait le choix ici de repartir des submorphèmes, plus connus sous le nom de phonesthèmes (Firth 1930), fédérant plusieurs vocables autour d’un ou de plusieurs noyaux conceptuels. Il s’agit par ailleurs de combinaisons de gestes articulatoires qui peuvent impliquer des termes d’origine onomatopéique ou non onomatopéique et qui marquent donc une unicité phono-articulatoire autorisant des correspondances transmodales et/ou multimodales (Bottineau 2012b). Nous avons opté ici pour les groupes consonantiques en KR et GR comme dénominateurs communs pour la diversité des modalités qui y sont représentées par-delà l’hétérogénéité sémantique et étymologique observable. Nous chercherons à explorer dans une perspective diachronique et synchronique l’exploitation de différentes motricités corporelles et les variations constatables en accordant une importance de premier plan à l’expérience vécue tant linguistique que non langagière. 1. Corporéité, expérience et multimodalité de la parole 1.1 Emergence de la cognition par le corps Plusieurs travaux en sciences cognitives ont montré l’importance du corps dans l’émergence de la cognition (Lakoff & Johnson 1986, Barsalou 1999, Varela et al. 1993, Versace et al. 2018). La cognition incarnée est un paradigme issu de la théorie de l'évolution et repose sur le fait que notre système nerveux s’est notamment développé de manière à gérer les interactions perceptives et motrices avec l'environnement. Cette idée possède deux implications majeures : tout d’abord, la cognition ne se développe pas de manière isolée, mais émerge à partir du corps, ce qui la rend fondamentalement sensorimotrice et non abstraite. Il importe donc d'étudier l’émergence de la cognition dans le contexte de son corps et de son interaction avec l'environnement. Ensuite, la cognition n'est pas seulement un traitement d'informations venant de l’extérieur selon un principe computationnel input-output mais un support à l'action, favorisant les comportements adaptatifs, qui par retour la font évoluer de manière cyclique, de même que le corps qui lui est associé. La linguistique énactive (e.g. Bottineau 2013, 2017a,b), héritée des travaux de Varela et al. (1993), a appliqué à l’analyse du langage et des langues les fondements de la cognition incarnée, située et distribuée. Dans ce cadre, le signifiant apparaît comme un processus de construction articulatoire et visuelle (graphique) qui s’articule aux autres interactions corporelles qui construisent l’expérience non langagière. Quant au signifié, il correspond à la synthèse des expériences corporelles mémorisées construites en rapport avec l’être ou l’objet référé. Ainsi, l’expérience verbale, phono-articulatoire et l’expérience non langagière s’inscrivent en situation dans des actions simultanées ou consécutives qui contribuent de facto à leur association cognitive. L’émergence de la forme et du sens linguistiques s’opèrent simultanément en relation nécessaire avec l’environnement où se situe le corps parlant. A ce titre, la nomination d’un objet pourra entrer en cohérence avec le rapport du corps à cet objet. Par exemple, fr. ballon, balle, boule, plein, bondé, pouf, bouffer (pour un vêtement), etc. incluent une bilabiale au titre de l’analogie entre le processus articulatoire (gonflement des joues généré par la prononciation d’une bilabiale) et l’appréhension visuelle de ces objets. La parole, quant à elle, constitue un processus complexe bien observé entre autres par Fónagy (1983) et qui repose sur l’exploitation multimodale du corps, comme le rappellent Bohas et Saguer : La relation mimophonique [i.e. l’existence d’un rapport analogique ou mimétique immédiatement reconnaissable non seulement pour le linguiste, mais également immédiatement saisissable par le locuteur ou l’allocutaire d’une pratique spontanée et intuitive des échanges verbaux au quotidien] concerne l’ensemble du travail moteur et sensoriel sur la voix (phonê) et non pas simplement le son, elle peut concerner n’importe quelle(s) propriété(s) percevable(s) du geste articulatoire ou du signal acoustique : elle s’inscrit dans la multimodalité des systèmes sensoriels (ouïe, toucher, vision). En outre, elle engage différemment les points de vue élocutif et/ou allocutif selon le partage des sensations concernées. Ainsi, la perception auditive du signal acoustique est accessible aux deux interlocuteurs ; la proprioception tactile du geste articulatoire moteur par les capteurs nerveux situés dans la cavité buccale et la langue est accessible au seul locuteur ; et la perception visuelle de la gestuelle visuo-faciale est accessible au seul allocutaire. (Bohas et Saguer 2012 : 5) Comme l’illustre le dénommé « effet Mc Gurk » (Mc Gurk & Mc Donald 1976), la compréhension du message au cours d’une interaction verbale repose effectivement tout à la fois sur la dimension sonore et visuelle de la parole. En l’occurrence, les différentes motricités ont été dissociées et décalées par les chercheurs grâce à un montage audiovisuel. Cette expérience montre que l’altération de l’image parasite la perception auditive du sujet. En l’occurrence, la perception visuelle d’un /ba/ a été couplée à la perception auditive d’un /ga/. Le paradoxe créé par la synchronisation des deux séquences visuelle et sonore non correspondantes amène le cerveau à reconstruire la perception d’un /da/ (composé d’une dentale sonore), basé sur la synthèse entre les deux motricités à un niveau intermédiaire entre la zone vélaire de /ga/ et la zone labiale de /ba/. La construction de la perception sonore en troisième personne passe donc nécessairement par la mobilisation simultanée de plusieurs modalités associées dans l’acte articulatoire, basée à tout le moins sur des coordinations visuelles et auditives. 1 Les circonstances normales et régulières d’interlocution contribuent en effet à associer vision et audition et à se présenter ainsi dans l’expérience mémorisée qu’en ont les sujets parlants. L’intérêt de la multimodalité de la parole pour notre propos est que l’onomatopée est décrite comme la reconstruction sonore d’un aspect de l’environnement. Or, si la parole est également d’ordre visuel, la question se pose de l’articulation entre les différentes modalités tant en synchronie (appariement dialogal) qu’en diachronie (changement de modalité). 1.2 L’exploitation de l’expérience et de la multimodalité corporelles au niveau submorphologique Les submorphèmes, tels que nous les entendons ici, sont plus connus dans le lexique anglais comme phonesthèmes (Firth 1930), groupes de deux consonnes ; ils se réalisent en mot sous la forme d’unités situées en amont du niveau de référence morphématique, d’où la terminologie employée. Sur le plan sémantique, ils correspondent à une micro-synthèse d’expériences sensorimotrices participant à la synthèse globale du signe linguistique (signifié). L’acte articulatoire à l’origine de ces groupes phonétiques se présente à des degrés divers comme iconique de l’action correspondant à celle indiquée par le vocable en discours. Bottineau (2017a,b) les décrit comme des modèles kinésiques de coordination multimodale (préhension, vocalisation, vision, etc.) qui participent à la construction de l’expérience. L’auteur donne les exemples du groupe SP en anglais qui fédère des vocables liés en situation aux expériences de “rotation, centrifugation / éjection” tels que sponge, spear (relation avec l’objet manipulé), speak, spit, spank (expérience corporelle), spatter, spark, spill (actions externes) (ibid.). Si ces correspondances forme-sens ne sont pas systématiques du fait notamment de l’obscurcissement relatif et aléatoire des formes en diachronie, il est possible d’en retrouver des exemples dans plusieurs langues, dont le français et l’espagnol, les deux langues qui nous occuperont ici. L’expérience d’éjection est par exemple détectable dans des situations d’emplois de fr. exploser, bousculer, dissiper, pousser, séparer ; esp. disparar « tirer », disputa « débat, dispute », espantar « effrayer », despegar « décoller », escupir « cracher », resplandecer « resplandir », soplar « souffler » ou métaphoriquement fr. spécial/ esp. especial. Quant à l’expérience de « rotation centrifuge », elle est visible dans fr. respirer / esp. respirar, esp. resbalar « rouler, glisser ») ou au sens figuré dans fr. esprit/ esp. espíritu (e.g. avoir de l’esprit : tener espíritu) 2 . 1 Le lecteur pourra accéder à une autre vidéo plus récente de Lawrence Rosenblum, chercheur en psychologie à l’Université de Californie (Riverside), à l’URL suivante : https://www.youtube.com/watch?v=2k8fHR9jKVM (dernière consultation le 30/07/2023). 2 Comme l’auteur l’aura remarqué, les réalisations des submorphèmes et leur syntaxe en mot dépendent de chaque langue-culture. Les langues romanes, par exemple, posséderont des séquences plus libres que l’anglais. Les statistiques de correspondances forme-sens varient également d’une langue à l’autre. Pour un panorama de ces questions liées à l’interculturalité, voir Grégoire (2022b : 109ss). 2. Les submorphèmes KR et GR en synchronie actuelle Le point de départ de la réflexion se situe dans le constat de ce que les groupes KR et GR – potentiellement présents dans des onomatopées à haute fréquence d’emploi comme fr. crac, grr(r) ou be(u)rk – sont associés à plusieurs modalités de l’expérience vécue (sonore et visuelle, entre autres) dans plusieurs langues, comme l’ont montré certains auteurs à propos du latin (Leonardi 2015) ou de l’anglais (Chadelat 2008, Farina 2020, voir infra). Par ailleurs, ces deux groupes consonantiques sont très proches sur le plan articulatoire dans la mesure où seul le trait de sonorité les distingue sur un des phonèmes impliqués. L’objectif ici n’est pas d’effectuer un recensement exhaustif des cas positifs et négatifs de correspondances morphosémantiques mais d’établir les principales modalités représentées dans les paradigmes des mots en KR et en GR (ou leurs variantes formelles) en espagnol et en français. Il s’agira ensuite d’évaluer leurs conditions d’émergence et leur possible motivation. En somme, il importe de montrer comment des expériences ou actions relevant de modalités corporelles distinctes peuvent entrer en cohérence avec les mêmes groupes consonantiques. Un premier panorama de l’état de l’art au sujet de ces submorphèmes s’avère donc nécessaire avant l’application aux idiomes qui nous occuperont dans ce travail. 2.1 Expériences et modalités associées aux submorphèmes KR et GR mises au jour en anglais et en latin Déjà en 1653, Wallis accorde à ce groupe phonétique en anglais le sens de « something broken especially with crackling noise, or curved and twisted ». Les vocables correspondant à cette description sont par exemple crack, creak, crackle, crickle, cruckle, cry, crave, crow, crush, crop, crackle, crouch, crinkle, creep, etc. (apud. Leonardi 2015 : 19). Or, toujours en anglais, selon Tournier (1985), le submorphème KR renvoie tout aussi bien à l’expérience sonore de « craquement, croassement, crissement » qu’à l’expérience visuelle de « non-rectiligne ». A l’action de cassure elle-même générant un bruit sec mentionnés par Wallis, il ajoute l’expérience visuelle des fêlures qui en résultent crick « torticolis », cranny « crevasse », creek vx, « lézarde, fissure ». L’auteur étend même ce constat à des expériences visuelles de nonrectiligne non nécessairement liées dans l’expérience à une cassure tels que crook « crosse », cross « croix », crank « manivelle », crab « crabe », crumpled « froissé », crawl « ramper », crazy paving « sol aux pierres irrégulières et non rigoureusement plan », crest « crête », crock « objet fourchu ». Chadelat a alors observé pour ce submorphème qu’il existe un continuum entre les mots renvoyant à une expérience auditive et à celles qui mobilisent d’autres motricités corporelles : le marqueur sub-lexical des termes de la série reproduirait le bruit de craquement caractéristique des objets durs qui se brisent ou se fissurent, et à la faveur d’un transfert fonctionnel faisant fond sur l’expérience, évoquerait le tracé non-rectiligne des fentes ou des fractures résultant d’un choc ou d’une collision et perceptibles sur des morceaux au contour irrégulier. Le caractère bivalent de cette séquence phonologique (à la fois onomatopéique et idéologique) procèderait en quelque sorte d’une filiation symbolique de la valeur imitative à la valeur suggestive dans le cadre d’un transfert notionnel entre les dimensions auditive et visuelle. (Chadelat 2008 : 88) L’auteur montre ainsi que l’expérience mémorisée associant le bruit de craquement à la fissure et leurs variantes respectives est globalement bien ancrée dans l’esprit des sujets parlants, ce dont le lexique se fait le témoignage. En appliquant son analyse au lexique latin, Leonardi fait les mêmes constats mais ajoute un fondement articulatoire à l’expérience non langagière en précisant par exemple que “the roughness of R gives to the CR- phonestheme the meaning of “ripple” as in English crouch and crinkle and indicates all that is rough and crisp, as in English crisp and cracker, also passing figuratively from roughness to asperity” (2015: 20). C’est ce qu’illustrent les exemples suivants : crinis "cheveux", crispus "frisé", "bouclé", "ondulé", crispare "onduler", "friser", crista "crête", crusta "croûte", "écorce", "coquille", crustata "crustacé", crustum "pain plat", crustula "pain plat", d’une part et crudus "cru", "aigre", "immature", "brut", crudescere "serrer", "devenir violent", crudelis "cruel", cruor "sang" (émanant d'une plaie), cruentus "cruel", "sanglant", crux -cis "croix", "torture", d’autre part. En ce qui concerne l’intersection formée par des angles droits (e.g. crux -cis "croix", cratis "grille", "treillis", craticula "grille", crus -ris "jambe", "pilier"), l’auteur précise que [t]his idea of cross intersection leads to the conception of a warped mesh to be used as a filter or sieve. It follows that a crimen was originally not an evil deed, but a proof for discerning guilt. These CR- terms are similar to the Greek κριτήριον, κριτικός, and κρίνω, which extend the idea of discernment to thought, so it is not unlikely that in Latin the term designating the brain stems from the same CR- root with the meaning of discernment organ, rather than from the root, which means “horns”. (Leonardi 2015 : 21) Il articule ainsi étymologiquement les sens de "tamis", "critère" et de "discernement", et inclus creber "épais", "dense", cribrum "tamis", cribellum "tamis", crimen -inis "crime" (essayer de discerner et de discriminer), cernere "tamiser", "discerner", "comprendre", certamen "procès", "preuve", "course", "combat", certus "certain", "sûr", "fixé", "décidé", certare "concourir", "combattre", cerebrum "cerveau" (organe de discernement), cerebellum "petit cerveau", "cervelet", cervix -icis "col de l'utérus", "nuque", "cou". Quant au submorphème GR, il est possible d’avoir un aperçu de son périmètre conceptuel en anglais à l’aide de Farina (2020), qui a synthétisé les catégories sémantiques mises en œuvre par les formes monomorphématiques commençant par /gr/ et listées dans l’OED [Oxford English Dictionary]. Nous reproduisons ici le tableau exposé dans son travail : Occurrences de catégories Fréquence brute Proportions (%) cri/plainte/colère/effroi 73 27,86% concassage/grattage/sable 39 14,89% plante/fluide/sol/aliment 32 12,21% maintien/embrayage/toucher 27 10,31% bas/profond/creuser 27 10,31% museau/dents/corps/tissus 27 10,31% son/voix/énoncé 23 8,78% grossier/épais/rugueux 14 5,34% Tableau 1. Synthèse des catégories sémantiques des monomorphèmes en gr- basée sur l’OED selon Farina (2020 : 49) (nous traduisons) On retrouve dans cette étude plusieurs constats effectués par Waugh (1994) et Abelin (1999) sur la mauvaise humeur ou la plainte (e.g. grim « triste », gruff « bourru » ou grumble « grincheux » grumble, grunt « grogner », groan « gémir , grieve « chagriner », grudge « rancune », gripe « râler ») 3 , ou encore par Philps (2008) sur la préhension (e.g. grab « saisir », grapple « grapiller », grip « saisir », grope « tâtonner » et grub « fouiller »), mais elles apparaissent ici précisées et quantifiées. Il est tout d’abord intéressant de constater la proximité expérientielle avec ce que nous avons observé plus haut au sujet de KR, comme le cri, le son/la voix (e.g. graunch ou grint « émettre un bruit de craquement ou de grincement »), d’une part 3 On retrouve là l’émergence de l’onomatopée « grrr » comme la manifestation sonore non verbale du raclement guttural prolongé en vue d’exprimer un mécontentement. ou le concassage/grattage (e.g. grind « réduire en poudre », qui s’approchent de la cassure, d’autre part. Quant au groupe GR, ses spécificités se trouvent surtout dans l’appréhension à la fois visuelle et sonore de l’expression d’un sentiment souvent négatif ou d’une humeur. Soit, par exemple, le frottement désagréable indiqué par certaines formes commençant par /gr/ [grind « broyer », grate « râper/gratter », grovel « ramper » ou grub « bouffer » (Waugh 1994 : 59)]. Ces formes sont toutefois assez proches de celles contenant le submorphème KR telles que scrape « racler », scratch « gratter », score « graver » ou rake « râteau ». On ne s’étonnera pas que des situations où un objet se casse (cassure imitée par l’onomatopée « crac ») suscite un énervement (pouvant être associé à l’onomatopée grr(r)) ou l’inverse, de manière circulaire. Leonardi a fait le même constat en latin4 en étendant aux concepts de granularité et de gradation qu’il illustre à l’aide de gradus "degré", "grade", "rang", gradi "marcher", "avancer pas à pas", gradatim "pas à pas", "progressivement", gradatio "gradation", "escalier", gradatus "gradué", gressus "pas", "démarche", gressio "démarche", grassari "marcher", "errer", grassator "vagabond", "criminel". Quant à la granularité (groupe d'éléments discrets), exemple est donné de granum "grain", "blé", "graine", granarium "grenier", granatum "grenade" (fruit à grains), grando -inis "grêle" (grains de glace), grumus "motte", "monticule de terre", grumula "coquille", gramen -inis "herbe", "tige", "souche", graminosus "herbeux", gremium "matrice" (où la graine est plantée). Enfin, le concept de « groupe » se retrouve dans grex -gis "troupeau", gregare "agrégat", gregatim "en groupe", grandis "grand", grandire "agrandir", gravis "lourd", "charge", "important", gravare "accabler", "charger", gravitas "gravité", "lourdeur", "gravité", gravidus "lourd", "chargé", "abondant", gravida "femme enceinte", gravidare "féconder", graviditas "grossesse" (Leonardi 2015 : 12-13). Il existerait donc un continuum en latin entre la non-rectilinéarité, le craquement, la cassure, d’une part et la granularité et la notion de groupe, d’autre part, matérialisé par l’expérience phonatoire. 2.2 De l’expérience non verbale/non langagière à l’expérience phono-articulatoire multimodales : mise en lumière de quelques cohérences Pour expliquer les situations auxquelles renvoient les mots en /kr/ de la langue anglaise (dotés d’un r rétroflèxe), Bottineau a par exemple évoqué le « pouvoir évocateur de l’occlusion suivie d’un raclement d’un point de vue tactile » (2003 : 214). Cela est confirmé par Leonardi au sujet de la langue latine qui indique que « CR- expresses a sound similar to GR- but sharper than KL- due to the presence of the R, which gives greater roughness » (2015 : 19, nous soulignons). Et Leonardi d’indiquer au sujet du submorphème GR que may be considered a variant of GL- in which the R replaces the L, thus imparting greater strength. Plato considers the letter rho a typical expression of movement because in its ruling, the tongue is stirred maximally. According to Leibniz (1705), more precisely, the R is the natural expression of a hard movement in contrast to the L, which instead expresses a soft movement. With regard to onomatopoeia, the root G+R always refers to a sound emitted from the throat, but is more intense and shrill, for it expresses gobbling or gargling rather than swallowing, and croaking rather than clucking. (Leonardi 2015 : 11) En effet, le caractère occlusif à un stade précoce du cheminement expiratoire retrace une interruption, une coupure par blocage du flux oral que le raclement de la gorge prolonge comme un acte de gravure ou de creusement (cassure)5 . Par ailleurs, Monneret (2003 : 99) dans un 4 L’auteur rattache notamment ce submorphème à des onomatopées indiquant les actions de "bouillonner", "se gargariser", "coasser" : gurges -itis "tourbillon", "vortex", gurgulio -onis "gorge", gargala "trachée", ingurgitare "jeter dans un tourbillon", "gober", graculus "corbeau", gracitare "coasser" (cri de la grenouille), grillus "grillon", gruis "grue", grunnitus "grogner" (cri du cochon). 5 On retrouve du reste cette expérience de « coupure » ou de « cassure » chez plusieurs mots appartenant au périmètre du submorphème SK, contenant le même phonème vélaire, tant en espagnol qu’en français. Soit en tableau récapitulatif des principales caractéristiques psychologiques rattachées aux oppositions phono-articulatoires, évoque le schéma /occlusive sourde + r/ comme statistiquement lié à un caractère plus rapide et plus agressif.6 Fónagy a par exemple retenu de ses expérimentations qu’« [i]l apparaît de ces tests que les enfants sourds interprètent, tout comme les enfants normaux, le /r/ comme plus bagarreur, plus masculin ; les occlusives [palatales] comme plus humides par rapport à /t/, /d/, /u/ ; le /k/ plus dur que le /l/ […] » (1983 : 69). Leonardi complète ces propos en expliquant comme suit la cohérence phonosémantique avec les expériences de gradation et de granularité : […] the R turns out to be the only phoneme with a periodical sound in which the periodicity is clearly distinguished by the human ear. Even the vowels are periodic sounds, but they are repeated at frequencies too high to be distinguished as such, so they appear as continuous sounds. Instead, the R is clearly perceived as “repetition” because it is modulated by the vibration of the tongue, much slower than the vibration of the vocal cords. Therefore, the GR- phonestheme expresses the idea of multiple discrete elements arranged in series such as “degrees”, or grouped as “grains”. (Leonardi 2015 : 12). En outre, dans le tableau de Monneret, la sonorité des phonèmes est rattachée statistiquement à la notion de grandeur, ce qui pourrait expliquer que le grondement ou le grognement rattachés au submorphème GR apparaissent comme plus profonds et possèdent plus d’écho qu’un cri sourd, éventuellement lié à la cassure, désigné par des termes du périmètre conceptuel en KR. Quant à l’expression grimaçante indiquée par plusieurs vocables, elle pourrait être associée en première approximation à une expérience faciale non sonore et non verbale rendue visible en troisième personne tel que le resserrement des dents et l’extension mécanique des muscles buccaux orbiculaires et zygomatiques, à l’image d’un rictus. Ajoutons enfin que Bohas (2021 : 215ss) évoque des séries de vocables français marquant une expérience visuelle et susceptibles d’entrer dans le périmètre du submorphème KR sous la matrice {[dorsal]}, tels que grotte, creux, croc, crochet, crosse, grappin, corne, cravate, crépu, etc., au titre de la courbure des objets référés7 . La prononciation d’une consonne dorsale (ici /k/ ou /g/) suppose en effet mécaniquement l’arrondissement de la langue (cf. Jóhannesson 1949 apud. Bohas 2016, 2021). Ces constats ouvrent donc la voie à une application aux langues romanes, et plus particulièrement aux deux langues qui nous importeront ici : le français et l’espagnol. espagnol disecar (« disséquer »), cascar (« fissurer »), disco (« disque », impliqué dans la découpe), mascar (« mâcher »), masticar (« mastiquer »), rascar (« gratter, racler, grapiller »), mezclar (« mélanger », « couper un liquide »), tarascar (« mordre ou blesser avec les crocs »), tascar (« casser le lin ou le chanvre »), castrar (« castrer » ou « élaguer »), triscar (« mêler ou mélanger »), cascada (« cascade »), añascar (« enrouler, embrouiller »), escribir (« écrire »), escaque (« cases du jeu d’échecs ») (Grégoire 2021). En français, on relève par exemple disséquer, scier, disque (impliqué dans la découpe), mastiquer, casser, cascade, scalp, scinder, scoliose, scarifier, esquinté, scorie (Grégoire 2022a). 6 Le tableau de Monneret a été réalisé à partir des informations contenues dans les travaux de Jakobson, Roman et Waugh, Linda, La charpente phonique du langage, Paris, Les Editions de Minuit, 1980, de Peterfalvi, Jean-Marc, Recherches expérimentales sur le symbolisme phonétique, Paris, CNRS, 1970, et de Fónagy, Ivan, La vive voix. Essais de psycho-phonétique, Paris, Payot, 1983, ainsi qu’indirectement à ceux de Chastaing : Chastaing, Maxime, «Le symbolisme des voyelles, signification des i», Journal de Psychologie, 1958, 55, p. 403-423 et 461-81 ; id., « L'opposition des consonnes sourdes aux consonnes sonores a-t-elle une valeur symbolique ?», Vie et langage, 1964, 147, p. 367-370 ; Id. «Dernières recherches sur le symbolisme vocalique de la petitesse», Revue philosophique, 1964, p. 41-56, Id., «Si les R étaient des L…», Vie et langage, 1966, 173, p. 468-472 et 1966, 174, p. 502-507. 7 Ajoutons en espagnol garfio « grappin », cuerno « corne » ou corbata « cravate ». 2.3 Rattachement aux modalités sonore et visuelle dans le champ de KR et de GR en français et en espagnol : observations en synchronie 2.3.1 Les corpus : premières observations formelles et catégories sémantiques Notre démarche vise à repartir de termes du français et de l’espagnol contenant des réalisations phonétiques des submorphèmes KR et GR par-delà leur hétérogénéité étymologique. Nous avons cherché les correspondances possibles entre ces termes et les modalités sonores et/ou visuelles attestées par les définitions dictionnairiques des termes en question. Tout d’abord, nous avons fait le choix d’un traitement conjoint des vocables contenant les groupes /kr/ ou /gr/ et leurs variantes dans la mesure où les mots du corpus possèdent aléatoirement des réalisations voisées ou non voisées entrant dans l’un ou l’autre périmètre conceptuel. L’autre motif est que nous avons pu observer qu’en anglais des croisements existaient entre les deux paradigmes bien qu’ils aient été abordés selon des protocoles et par des auteurs distincts. Par ailleurs, il a été observé que les structurations syllabiques du français et de l’espagnol pouvaient donner lieu à des réalisations submorphologiques plus libres qu’en anglais : non seulement synthétiques ([kɾ] / [gɾ]) mais également analytiques ([k-ɾ] / [g-ɾ]) voire inversives ([ɾk] / [ɾ-k], [ɾg] / [ɾ-g]) (Bottineau 2014 : 8-12, Grégoire 2022b : 109ss). A cela s’ajoutent les possibilités de réalisations multiples de la vibrante en espagnol [r] et les variantes approximantes de la vélaire sonore [ɣ] 8 . Tout cela complexifie la tâche du linguiste et rend difficiles les analyses statistiques artisanales. Pour autant, cette extension des corpus aux réalisations analytiques et inversives est fondamentale pour la prise en compte qualitative des expériences associées dans ces langues romanes. Enfin, bien que nous nous appuyions sur des dictionnaires généraux, le corpus que nous proposons ici se compose de termes aux fréquences d’emplois variées, d’un usage courant, plus restreint ou encore technique. Pour le français, nous avons opéré une extraction des formes correspondant aux réalisations submorphologiques mentionnées ci-dessus en début de mot (première ou deuxième syllabes)9 à partir de la liste de mots du CNRTL, soit 2534 vocables. Pour l’espagnol, nous avons procédé de même sur la base du Diccionario de la lengua Española, qui fait autorité dans le monde hispanique, soit 2957 items. Dans les deux cas, nous n’avons pas tenu compte des formes fléchies mais nous avons en revanche conservé les dérivés. Nous avons ensuite recensé les principales expériences auxquelles renvoient les vocables du corpus à la lumière des définitions lexicographiques en synchronie. L’observation de ces listes de vocables en KR et en GR dans chaque langue nous a conduit à établir plusieurs catégories sémantiques proches de celles données plus haut et qui marquent soit l’exploitation d’une modalité auditive (craquement et cri ; grognement / grondement) ; soit visuelle (non rectiligne, granularité / gradation ; contorsion du visage), les deux de manière conjointe (cassure) soit, enfin, des actions manuelles (scription, grattage). Le découpage de ces expériences tel que présenté ici reste subjectif mais nous ne prétendons dans un premier temps que d’illustrer la possible présence et l’éventuelle imbrication des modalités parmi les champs de référence des vocables étudiés. 8 Soulignons qu’il ne sera pas question ici d’évaluer la représentativité statistique de ces expériences dans les lexiques du français ou de l’espagnol. Le lecteur pourra trouver une estimation quantitative des périmètres submorphologiques en français et en espagnol sur la base des 5000 mots les plus fréquents dans Grégoire (2022b : 120ss). 9 Le début des formes étant plus important d’un point de vue cognitif dans les langues d’origine indo-européennes, nous nous sommes limité à ces positions afin de restreindre le corpus. 2.3.2 Les expériences sonores de craquement et de cri L’expérience du cri, en tant que production sonore gutturale, se trouve par exemple à l’origine de la nomination de nombreux oiseaux en français et en espagnol (cf. Grégoire 2012). C’est notamment le cas en français de fr. graille (« pie »), croasser, fr. corbeau / esp. cuervo, fr. grue / esp. grulla ; esp. croar / groar « cri de la grenouille », esp. graznido « cri ou chant d’oiseau », crascitar « cri du corbeau », urraca « pie », gorrión « moineau », garza/garcilla « oiseau semblable à la cigogne », carracacao « espèce de faucon », carraco, a : « canard » au Costa Rica, "rapace" en Colombie « espèce d’oiseau migrateur plus petit que la corneille » en Espagne ; grajo,a « geai », carracao : « oiseau de la famille des falconiformes », cacarear : « pour un oiseau : émettre des cris répétés », gruir « craqueter (pour la grue) », gorjear « gazouiller ». D’autres expériences sonores sont détectables comme avec grelotter (< grelot), cor ou carillon. Soit aussi les différents cris d’autres animaux fr. croasser ou esp. croar/groar « coassement de la grenouille ou du crapaud ». On le retrouve également la mobilisation de la zone gutturale pour le cri humain (potentiel ou effectif) dans fr. cri / esp. grito, fr. gorge / esp. garganta, fr.se racler la gorge / esp. carraspear, carcajada « fou rire », gresca « bruit, clameur collective », fregar « racler, frotter », roncar « ronfler », entre autres. 2.3.3 La cassure dans ses dimensions sonore et/ou visuelle Comme Chadelat l’a observé pour l’anglais, on détecte dans les deux langues étudiées les groupes KR et GR représentés dans des formes susceptibles d’évoquer un bruit de cassure mais également parfois une cassure marquée plutôt visuellement, peut-être par l’expérience qui lie les deux modalités dans ce contexte précis. Soit les lexèmes fr. croquer, craquer / « crac », crisser, grincer, écrouler, écraser, fracture, creuser, crever / grever, cramer, escarre, carie, écorcher, égratigner, grignoter, désagréger, corrosion, infarctus, figure [cf. (se) casser la figure], curer, gargouiller, cracher, carotteuse. On observe donc logiquement des termes susceptibles d’impliquer une certaine fragilité comme craie (e.g. friable comme la craie) ou cœur (e.g. fendre le cœur). On retrouve en espagnol notamment les cas suivants : gruñir « grincer » / esp. crujir, agrietar « craquer », crac, fractura « fracture », escarificar « scarifier », corrosión « corrosion », cara « visage, figure » (cf. romper(se) la cara « (se) casser la figure »). 2.3.4 Les expériences visuelles de gradation / granularité et de non-rectilinéarité La cassure peut également donner lieu à un morcellement et donc à la production de parties plus petites et plus nombreuses de même nature. Il est donc loisible d’ajouter les termes suivants appartenant au champ de la granularité ou de la gradation évoqués par Leonardi en latin : fr. groupe / esp. grupo, fr. grappe, fr. degré / esp. grado, fr. grand/gras/gros / esp. grande/gordo/grueso, fr. gradin / esp. grada, fr. grumeau / esp. grumo, fr. grêle/grésil / esp. granizo, fr. fragment / esp. fragmento, fr. gravier / esp. grava, et leurs dérivés respectifs dans chaque langue. Quant à fr. grain, granuleux, granit, grenu / esp. grano, granuloso, granito, granulado, ils illustrent l’articulation entre la granularité et la non-rectilinéarité du fait de leur forme courbe. Signalons également l’existence en espagnol du verbe garapiñar « fait de se solidifier [pour un liquide] en formant des grumeaux » (< CARAPINIARE « arracher, découper »). Quant à la non-rectilinéarité, il est possible de l’illustrer notamment à l’aide des vocables français crabe, cric(k), crique (« échancrure de paroi rocheuse »), courber, crépu, crête, cercle, carré, courroie, crochet / accrocher, caracoler « chevaucher en sautant, en cabrant le cheval », cruche, carafe, crâne, corne/écorner, créneau, agripper/grimper, gravier / graveleux, croiser/croix, cursives, écorce, couronne, crampe (« torsion du muscle », < germ. Kramp « courbé »), crampon, cran, corde, accorder, crémaillère, gruyère (fromage troué). En espagnol, on retrouve par exemple cangrejo [de mar] « crabe », cangrejo [de río] « écrevisse », cráneo « crâne », agarrar « accrocher », corona « couronne », cruz « croix », greda « argile utilisée en poterie », granate « grenat [minéral cristallin] », grapa « agrafe », grava « gravier », greña « chose entremêlée avec une autre », grieta « faille, fissure », gripar « gripper » grúa « grue », grujir « égaliser les bords de verre coupés », grupa « croupe », gurruñar « froisser », arruga « ride », cremallera « fermeture éclair », corvo « arqué », carbón « charbon (décomposition du bois) », ragua « extrémité supérieure de la canne à sucre qui a tendance à se courber du fait de sa finesse », carro « voiture ou autre objet roulant » (expérience de courbure/rotondité), horca/horquilla « fourche ». Des cas d’énantiosémie sont visibles avec fr. cours / esp. curso, fr. carrière / esp. carrera et leurs dérivés respectifs10. On détecte également des cas d’énantiomorphie (iconicité entre inversion formelle et opposition sémantique) avec règle qui marque nécessairement une rectitude et dont la réalisation du submorphème KR est inversée par rapport à ce qui est le plus fréquemment observé11 . 2.3.5 Les expériences sonores du grognement et du grondement Une différence fondamentale entre le grognement et le grondement, d’une part, et le cri, d’autre part, est que les premiers s’accompagne le plus souvent d’un prolongement sonore. Ils sont du reste favorablement associés à un sentiment de mécontentent ou à un comportement de bougonnerie. Ces vocables sont moins nombreux que ceux précédemment mentionnés référant au cri, peut-être précisément du fait de la spécification de leur contexte d’émergence, ce qui leur confère un statut hyponymique. En français, on retrouve grogner, grommeler, grincheux, gronder, et en espagnol, on détecte notamment gruñir « grogner », regañar « gronder », tigre « tigre », gritar « gronder », guarrear « gronder ». Dans ces situations, on constate que le submorphème s’accompagne parfois d’une nasale ou d’une voyelle nasalisée pour marquer le prolongement de la production sonore. Cela rappelle en cela ce qu’indique Chadelat au sujet du corpus des mots anglais en KR où « la nasale finale de /krn/ résonne par imitation » (2008 : 80), qui matérialise le prolongement sonore par un phénomène d’écho. 2.3.6 L’expérience visuelle de la contorsion du visage liée à une émotion négative Comme en anglais, les formes impliquant un grognement ou un grondement apparaissent comme liées expérientiellement à un état d’esprit ou à une émotion négative ressentie et dont le visage et plus largement le corps se font le témoignage. L’expression de cette émotion peut alors relever du langage verbal et constituer un acte volontaire ou bien un acte spontané parfois rendu visible de manière inopinée consécutif d’une sensation déplaisante. En l’espèce, l’expérience peut donc émerger sur la base de modalités gustatives ou tactiles également pour un résultat visuel (3ème personne) et proprioceptif (1ère personne). On songera ici par exemple à fr. grimace/grimé, acre, aigre, cru, cruel, grave, médiocre, acariâtre, faire grise mine, caricature, simagrée(s), rictus « sourire grimaçant », grigne, grincheux, querelleur, agressif, renâcler. Ajoutons enfin les formes onomatopéiques berk / beurk qui apparaissent comme représentatives et qui incluent de facto une expérience sonore. En espagnol, on relèvera notamment amargo « amer », acre « acre », crudo « cru », agrio « aigre », grave « grave », 10 L’énantiosémie peut- être décrite comme la combinaison de deux conceptualisations a priori opposées (ici la rotondité et la rectitude) mais présentées comme complémentaires dans l’expérience corporelle vécue (ici la rotondité d’une roue est nécessaire au parcours de la rectitude). 11 Au sujet de ce phénomène, voir Grégoire (2022b). mediocre « médiocre », cara « visage » (cf. e.g. hacer/tener cara de vinagre « faire la tête », hacer caras « faire des simagrées »), lágrima « larme », agresivo « agressif », grima « contrariété », rictus « rictus », cruel « cruel ». Peut-être pouvons-nous intégrer ici l’expression faciale de dégoût liée à l’emploi de carca et de mugre « crasse [corporelle] ». En l’espèce, si les formes indiquant un grondement ou un grognement constituent plutôt la manifestation sonore du mécontentement, celles indiquant la contorsion du visage renvoient à une expérience éminemment visuelle, dont l’association peut être concrétisée in situ (cf. infra). 2.3.7 Les actions manuelles : la préhension, le grattage et la scription On relève dans le corpus plusieurs verbes désignant un acte de préhension ou un autre pouvant y être assimilé : agripper, grimper, accrocher, grappiller, cramponner, crisper, griffer, gratter. Les actions manuelles nécessitent parfois un outil médiateur comme celles évoquées par gribouiller, griffonner, écrire. Par ailleurs, l’analogie gestuelle est également perceptible dans l’extension aux membres inférieurs avec le verbe accroupir. En espagnol, on détecte par exemple garra/agarrar « griffe » / « saisir, accrocher », [poner] crampones « cramponner », crispar « crisper », rascar « racler, gratter, grappiller », arrancar « arracher », arraigar « ancrer », hurgar « fouiller (en profondeur) », escarbar « gratter, fouiller », encorvado « accroupi », d’une part et garabatear « gribouiller », escribir « écrire » (paronyme de escarbar), cortar « couper », d’autre part. Ajoutons que la forme grecque xειρο « main » (< indo-européen *ĝhesor) a donné le préfixe quiro- en espagnol (e.g. quirurgo « chirurgien », quiropráctico « chiropracteur ») dotée du groupe [k-r], réalisation possible de KR, parfois palatalisé en français. Ce recensement semble illustrer a priori en français et en espagnol les propos d’Abramova et al. (2013 : 1698) qui associent le submorphème GR en anglais à « threatening noise, anger, grip », où donc l’empoigne serait liée expérientiellement à un sentiment de colère. La crispation des muscles des mains, comme celle du visage notamment, peut en effet aller de pair avec une situation de stress générée par une humeur négative, voire une tension musculaire du faciès. Nous verrons plus avant quelles pourraient en être les hypothèses complémentaires. 2.3.8 Synthèse et conséquences théoriques des observations Il est tout d’abord possible d’observer que plusieurs des actions évoquées par les vocables en KR ou en GR associent plusieurs modalités par l’expérience : par exemple, l’onomatopée berk/beurk ou les adjectifs âcre et aigre, évoquent à la fois une grimace et le son émis évoquant un déplaisir, les actions de gratter et de fouiller sont associées à un bruit, les larmes au cri, le grognement à un mouvement du faciès, la colère et le cri à une action manuelle et la cassure possède une dimension sonore dans l’acte (bruit associé) ou visuelle dans son résultat (nonrectilinéarité). Certaines expériences sont aussi uniquement sonores comme celles des cris d’oiseaux et peuvent pour la plupart être caractérisées comme étant onomatopéiques. En revanche, l’ensemble des expériences visuelles (courbure/non-rectilinéarité, contorsion des traits du visage ou resserrement des mains et des dents) posent la question de leur statut. Sontce des expériences visuelles systématiquement associées aux expériences sonores du fait du caractère conjoint de leur émergence au sein de situations données (iconicité de second degré) ? Ou bien peuvent-elles se présenter comme des marques d’un mimétisme visuel portant sur des aspects non sonores de l’acte articulatoire, comme le postule Bohas (2016, 2021) pour la matrice {[dorsale]} liée à l’expérience de « courbure » (iconicité de premier degré) ? En somme, pourrait-on postuler l’autonomie de l’exploitation de la modalité visuelle en synchronie et en diachronie ? Afin de répondre à ces questions, il importe d’introduire une composante diachronique susceptible de distinguer les cohérences imputables à une motivation originelle ou plus récente. Par ailleurs, il incombe de tenir compte de facteurs liés à l’expérience vécue pour faire la part de l’association intermodale in situ et de la motricité corporelle initialement exploitée. Nous nous proposons donc de combiner ces deux principes afin de retracer la ou les modalités (souvent sonores ou visuelles) rattachées initialement aux vocables entrant dans le champ de KR et de GR et les changements qui ont pu s’opérer. 3. Changements de modalités par association expérientielle en diachronie L’objet de cette partie est d’analyser des vocables du corpus qui ont présenté un changement de modalité en diachronie afin de vérifier s’ils possèdent une origine onomatopéique ou s’ils exploitaient initialement d’autres motricités corporelles que l’audition. Pour ce faire, nous nous proposons de remonter à l’étymologie la plus ancienne attestée et de recenser les variations dans l’exploitation des motricités en diachronie. Selon les cas, les étymons recensés sont soit en (proto-)indo-européen soit bien plus récents, par exemple en francique. Les étymologies présentées ici sont issues du CNRTL pour le français, complétées par celles du dictionnaire du latin de Ernoult-Meillet (2000). Quant à l’espagnol, nous nous sommes basé sur les propositions critiques de Corominas et Pascual (1980) et du dictionnaire étymologique en ligne Etimología de Chile (2001-2023). Nous avons enfin recouru au dictionnaire de Pokorny (1959) pour confirmer certains rattachements anciens en (proto-)indo-européen pour les deux langues. 3.1 De l’expérience sonore d’origine onomatopéique à l’expérience visuelle Parmi les mots relevant du périmètre de KR et de GR, on observe des cheminements étymologiques marquant le passage d’une modalité sonore à une modalité visuelle basée sur l’expérience. Par exemple, le substantif crécelle provient du vieux-francique *kriskjan, et luimême d’une onomatopée cric, crac, crec évoquant un bruit sec. Il en est ensuite venu à indiquer en moyen français « moulin de bois » dont la non-rectilinéarité de la manivelle est évidente. Il s’agit ici d’un changement de modalité corporelle par métonymie, du son à l’objet mais l’association in situ entre les expériences auditive et sonore est bien patente. On retrouve également les verbes de même origine onomatopéique crisser, grincer ou grincher (adj. grincheux). Le verbe crisser a par exemple donné lieu à des expériences proprioceptives générées par l’acuité et l’intensité sonore, telles que dans l’illustre l’exemple suivant : Un autre médecin dont le ton autoritaire faisait crisser mes nerfs tendus. (Maurois, Journal, É.-U., 1946, p. 251). (CNRTL, s.v. crisser) En espagnol, crécelle se traduit ordinairement par carraca ou matraca, actualisés par le submorphème KR. Ils semblent également être tous deux d’origine onomatopéique : carraca constitue une expansion de l’onomatopée crac et matraca provient de l’arabe maṭráqa « marteau » (Corominas & Pascual, s.v.). Dans ce deuxième cas, on notera un croisement des expériences du « coup » (rattaché à la racine T-K selon Guiraud 1986) et du son qu’il émet indiqué par le submorphème KR12 . Le verbe croquer, quant à lui, proviendrait d'une racine onomatopéique krokk-, exprimant un bruit sec (FEW t. 2, p.1359), de même que l’interjection croc 2 selon le CNRTL se rapportant au bruit de ce qui craque ou croque sous la dent. Si l’origine onomatopéique de croquer est manifeste, la question se pose de l’éloignement apparent des emplois de « frapper sous la dent » et « dessiner ». Si le sens de « dessiner » provient de « faire à la hâte, esquisser un ouvrage » et 12 Nous nommons ce phénomène l’expérience composite qui constitue la représentation au niveau submorphologique du croisement d’expériences convoquées par l’appréhension sensorielle d’une situation donnée (ici « celles de coup » et de « cassure », où a fortiori l’une peut être consécutive de l’autre). Voir par exemple à ce sujet Grégoire (2021). est apparenté à croqué « pris sur le vif » (cf. CNRTL), chaque emploi pourrait correspondre à la mise en œuvre d’une expérience propre, l’une auditive émanant d’un craquement sous la dent, l’autre visuelle construite sur la base des lignes brisées du croquis. Il se pourrait que ce verbe se trouve à l’intersection des deux expériences et que le changement de modalités ne soit pas strictement du même ordre que dans les autres cas13 . Il s’agit d’une situation supplémentaire où la non-rectilinéarité et l’onomatopée se trouvent en lien de cause à effet direct. L’espagnol grieta « fissure » provient de crepta « craquement » et lui-même du lat. crepitare « crépiter ». On perçoit là encore le changement dans les motricités exploitées pour l’émergence du sens, soit le passage d’une modalité sonore à une modalité visuelle par le truchement de leur association in situ14 . Un autre exemple serait fr. carte / esp. carta issus tous deux du lat. charta, lui-même du grec χάρτης chártēs en lien avec χαράσσω, kharássô « gratter, inscrire ». Ces étymons sont à rapprocher des dérivés du lat. scrivere « écrire » provenant lui-même du proto-indo-européen *(s)kreybʰ (« tailler, sculpter »). Or s’il s’agit ici d’une action potentiellement sonore du fait de la prise en charge du bruit associé à la sculpture ou au grattage, on note également un lien visuel avec la cassure. Il s’avère donc difficile ici de distinguer et de hiérarchiser conceptuellement les deux modalités. Dans tous ces cas, on se trouve donc en présence d’une motivation basée sur l’expérience sonore associée in situ à la non-rectilinéarité comme dimension visuelle résultative. Cela confirme les déductions de Chadelat au sujet du continuum entre l’onomatopée et l’expérience visuelle dans le corpus des mots en cr- de l’anglais construits sur la base d’une association extralinguistique vécue comme telle. 3.2 De l’expérience visuelle à l’expérience sonore On observe parfois le processus inverse : une expérience visuelle en (proto-)indo-européen peut ensuite donner lieu à une expérience sonore. Soit, tout d’abord, le cas de croc (classé comme homographe de l’onomatopée croc (« bruit de craquement sous la dent ») par le CNRTL (s.v. croc 1). Contrairement à l’onomatopée, cette forme aurait en effet suivi le cheminement suivant : PIE *Ke(n)g- / ke(n)k- « crochet, grappin, poignée » > vieux norrois krokr > vieuxfrancique krok > lat. *croccus > croc (« pointe recourbée ») (XIIème siècle) → crocs « dents de certains animaux » (avant 1673). Selon Pokorny (1959 : 917), le sens de « frapper » (> ang. hit et kick), qui suggérerait une origine onomatopéique, viendrait en revanche d’une racine indoeuropéenne à s- mobile *(s)k(h)ai- et ses dérivées *(s)k(h)ai-d- et *(s)k(h)ai-t-. Selon ces hypothèses, il conviendrait donc de distinguer pour croc l’utilisation des dents animales nommées pour leur propriété acérée et le bruit de craquement sous les dents, bien que cela n’exclue pas des croisement dus à l’expérience. Le dérivé crochet marque également un rattachement à une expérience plutôt visuelle. Le cas de grésil(ler) est également représentatif de ce type d’évolution. Il indique à la fois le grésil qui tombe en tant qu’expérience visuelle de petits grains et le bruit qu’il génère en touchant le sol. Ce terme provient en effet du lat. gracilis, dérivé de cracens « mince, svelte », 13 Guiraud, pour sa part, rattache le verbe croquer à la racine T-K réalisée [k-k] et liée à l’expérience de « donner un coup ». Il évoque alors « l’image du « coup de patte » du dessinateur » pour le lien entre les deux emplois (1994 : 233-234). Cette hypothèse repose sur la stabilité du sème de « coup » dans le cheminement étymologique observé en français : onomatopée croc > croquer « frapper » (XIIème siècle) > croquer « briser » (XIVème siècle) > croquer « briser sous la dent » (XVème siècle). Il faut cependant préciser que Guiraud ne se place pas rigoureusement dans une démarche submorphologique et qu’il ne repart pas des travaux fondateurs du début du XXème siècle sur ce thème. 14 On retrouve également en grec ancien κρέκω, apparenté au latin crocio, de l’indo-européen commun *krek (« frapper, craquer ») (Pokorny s.v. *krek), dans les sens de 1. Tisser (i.e. entrecroiser les fils), 2. Jouer de la lyre, 3. Émettre un son sec. avec le suffixe -ilis, provenant du vieux-francique *grisilôn « grêler », lui-même issu de la racine en indo-européen commun *krok « mince, svelte ». On retrouve donc ici la finesse du grain, elle-même en lien par son caractère groupé au submorphème GR et en tant que fragments de glace, au submorphème KR. Or l’expérience sonore dans ce cas est bien secondaire au vu de l’étymologie. Le son relié n’est en effet explicité qu’à partir du français avec le sens de « produire un bruit, semblable à celui d'un corps qui frit, à celui du grésil » (vers 1120) (CNRTL, s.v. grésiller), se rapprochant de crépiter, dont l’influence n’est pas à exclure. Quant à grailler, provenant également du lat. gracilis, il désigne à la fois les expériences sonores multiples suivantes « 1. Crier, croasser, 2. Parler d’une voix rauque ou enrouée, 3. Sonner du cor pour appeler les chiens (à la chasse) » et le sens de « manger » (CNRTL, s.v). Ce dernier sens constitue une dérivation régressive de graillon « restes d’un repas » en lien avec les étymons latin et indo-européen. On observe donc ici l’exploitation d’une correspondance transmodale entre la finesse/minceur et l’acuité sonore comme le mentionne le CNRTL. On parle par exemple de son ou de voix grêle ou encore d’esprit fin où est mise en œuvre l’acuité non sonore. Toutefois, la modalité sonore n’est que dérivée de la modalité visuelle selon cette correspondance, et la motivation originelle ne semble pas se baser sur une imitation acoustique. Les deux formes verbales, toutes deux employées intransitivement et considérées comme homonymiques par le CNRTL, pourraient ici aussi révéler deux expériences distinctes, l’une sonore (« crier », « claironner »), l’autre visuelle issue de la considération des restes de repas (par définition découpés ou fendus). Ainsi, tant dans le cas de grésiller que de grailler, le changement de modalité s’est opéré dans le sens visuel > sonore, ce qui ne semble pas corroborer l’hypothèse d’une motivation de type onomatopéique. La forme cric, quant à elle, s’inscrit dans des situations variées. La forme cric(-crac) entrant dans le réseau d’opposition I/A (cf. Bottineau 2009), correspond selon le CNRTL à une « [o]nomatopée exprimant le bruit sec d'une clef qui tourne dans la serrure, etc. ». Et les auteurs précisent que la forme cric peut parfois suffire pour y référer (cf. CNRTL, s.v.) Quant à la forme proche, également dupliquée, cricri, elle renvoie au « bruit du grillon ou de la cigale », CNRTL, s.v.). Et les auteurs du CNRTL de faire remarquer que selon FEW, ce dernier sens attesterait un autre mot se rattachant à une onomatopée de même forme phonique. Or la même forme cric correspond également à une « [m]achine munie d'une crémaillère et d'un système de roues dentées que commande une manivelle, généralement utilisée […] pour soulever à faible hauteur de fortes charges » (Ibid.) Le terme cric aurait alors été emprunté comme terme d'art militaire à l’allemand kriec […] avec peut-être rapprochement ultérieur de cric, onomatopée, suggéré par le bruit produit par le crochet du cric s'engageant dans les dents de la crémaillère » (Ibid.). On constate donc une situation de l’expérience supplémentaire de rattachement potentiel de l’expérience sonore liée au bruit de craquement/crissement à l’expérience visuelle de nonrectiligne. Toutefois, là encore, la nomination de cric 2 semble reposer sur la forme visuelle elle-même attestée par l’antériorité du sens de « machine à crémaillère ». Si nous observons à présent le substantif crapaud, selon le CNRTL, il provient du « germanique *krappa (« crochet ») en raison des pattes crochues du crapaud, probablement par l'intermédiaire de l'ancien français grape, crape (XIe s. « rafle, grappe de raisin », v. grappe; 1213 « crampon, grapin », voir agrafer, crampon et grappin) » (CNRTL, s.v. Nous soulignons). L’animal aurait donc été nommé ainsi pour la forme visuelle de ses pattes et non pour son cri, bien qu’il lui ait été associé par la suite. En revanche, le terme grenouille semble être d’origine onomatopéique car il provient du latin ranunculus, diminutif de rana « grenouille », lui-même de *rācsnā (cf. lat. rancare, raccare « miauler »). Pour le CNRTL (s.v. grenouille), « le /ɡ/ initial peut être dû à l’influence des mots qui imitent le chant des oiseaux (à comparer avec le latin graculus, gracillare) ». Cela n’empêche toutefois pas en français, là encore, des emplois relevant d’une dimension visuelle tels que celui de « [p]artie creuse qui est placée sur la platine et qui reçoit le pivot de la vis » dans le domaine de l’imprimerie (CNRTL, s.v.). Les vocables fr. carré / esp. cuadro, proviennent quant à eux du latin quadratus, participe passé adjectivé et substantivé de quadro (« équarrir, cadrer, faire cadrer, compléter »), procédant luimême du radical indo-européen *kwetwer- "quatre". Or, si le sens en indo-européen renvoie a priori à une expérience visuelle, celui d’« équarrir » en latin pourrait reposer sur l’analogie entre la brisure multiple de la ligne et la quadrature de la forme géométrique pour la formation des angles (cf. ang. square où l’on retrouve le submorphème SK lié au plan de coupe selon Bottineau 2010). Enfin, les termes fr. et esp. rictus, calqués sur le supin latin signifiant « bouche ouverte », de ringore « grogner en montrant les dents » (lui-même du radical *u̯er-g- « tourner, tordre » en indo-européen) marquent également un changement de modalités. En effet, si la motivation originelle semble reposer sur une expérience visuelle, la remotivation en latin s’est basée sur l’onomatopée liée au grognement. Le supin et les formes actuelles qui en découlent n’en ont ensuite conservé que la référence à l’expérience visuelle par métonymie, soit la grimace faciale associée au grognement. Le changement de modalité a donc pu s’opérer sur la base de l’association entre la torsion de la bouche et plus largement du visage et le grognement dans le cas de lat. ringore. En revanche, le participe passé latin rictus révèle l’exploitation de la seule modalité visuelle, qui s’est ensuite consolidée dans le passage au français et à l’espagnol pour référer à un sourire grimaçant. Les deux acceptions actuelles, l’une technique « contraction des muscles peauciers de la face due à un spasme nerveux et donnant au visage l'expression d'un rire forcé » (CNRTL, s.v.), l’autre courante de « sourire grimaçant », valides dans ces deux langues, confirment la prédominance et la stabilité de l’exploitation de cette motricité. 3.3 Incertitude eu égard à l’antériorité de la motricité exploitée Il existe enfin des cas, proches de celui de scrivere évoqué plus haut, dont l’expérience originelle est plus difficilement démontrable pour deux raisons principales cumulatives ou non : 1) le vocable en question possède une étymologie obscure ou incertaine, 2) la simultanéité des deux modalités est telle qu’il s’avère impossible de les dissocier dans l’expérience. Certains vocables ne s laissent donc conceptualiser que par la conjugaison de modalités in situ. Tel est le cas par exemple de esp. lágrima « larme », provenant du lat. lácrimam, copie du grec ancien δάκρυμα, dákruma, dérivé de dákrúô (« pleurer »), et celui-ci de la racine indo-européenne *dáḱru « larme ». Il s’avère difficile ici de séparer les deux expériences et de donner une origine comme onomatopéique ou visuelle tant les deux expériences apparaissent en l’occurrence indissociables. On a l’illustration de la multimodalité de la perception et du langage qui la construit. C’est aussi la manifestation du lien entre les deux expériences de contorsion du visage, d’humeur et de cri, ce qui abonde dans le sens d’un continuum sémantique basé sur l’expérience. De même, l’esp. arruga « ride », rugoso « rugueux » et vx rúa « rue », dérivés du lat. rugare qui proviennent de l’indoeuropéen reuk-, variante avec allongement guttural de la racine reu-2 « arracher, déterrer, ouvrir » explicitent autant la visualité que l’audition voire la dimension tactile ou proprioceptive du creusement. En l’espèce, il est ardu de se prononcer sur le fait que la motivation se soit opérée sur la base de l’expérience auditive ou visuelle. Pour autant, ces termes apparaissent comme la manifestation de la multimodalité de l’émergence du sens par le truchement de l’extralinguistique, et nous rappelle que l’onomatopée ne fait pas l’objet d’une interception isolée des autres modalités corporelles. On ajoutera enfin le verbe fr. gratter, qui se rattache vraisemblablement au germanique occidental *krattôn « frotter en raclant ». Il existe en indo-européen une racine *gerbʰ- : « gratter » chez Pokorny, qui pourrait de fait apparaître comme l’étymon le plus ancien. Les dimensions manuelle et proprioceptive sont celles qui apparaissent comme saillantes dans ces situations sans que l’on puisse en exclure totalement les deux autres modalités à l’étude. Nous pouvons donc observer que les processus articulatoires que sont les formes linguistiques peuvent être employés en référence à une expérience sonore et à une expérience visuelle, et ce de manière successive. Ces changements se retrouvent tant en synchronie qu’en diachronie et peuvent donner lieu à une iconicité de premier degré, nettement onomatopéique (fr. craquer, croquer, crier, gronder ; esp gritar, crujir, gruñir) ou de second degré (fr. crécelle, cric, croc 1 et 2 ; esp. carraca, lágrima). Par ailleurs, comme l’a également constaté Chadelat (2008 : 88- 89) à propos de plusieurs termes de l’anglais, les changements de modalités peuvent se faire de manière circulaire en mobilisant la dimension acoustique de l’expérience puis visuelle puis à nouveau acoustique ou inversement, comme c’est le cas de rictus. L’expérience vécue considérée holistiquement peut donc s’avérer d’un recours précieux pour justifier l’exploitation de telle ou telle en diachronie et en synchronie. Ce constat va dans le sens d’exploitations distinctes de situations analogues ou proches, dont l’imitation phonique (onomatopée) n’est qu’un des volets et où les autres modalités corporelles sont susceptibles d’intervenir selon les contextes en vue de l’émergence du sens. La multimodalité de l’expérience vécue pourrait alors donner lieu à des constructions sémantiques orientées culturellement et à des correspondances métonymiques plus ou moins stables et concrétisées en l’occurrence par la sollicitation d’une modalité corporelle précise. Si l’onomatopée imite le son, les autres modalités servent chacune à imiter l’aspect qui leur correspond. Pour notre propos, la question se pose donc des expériences visuelles qui ne se présentent a priori pas en lien avec une expérience sonore dans leur cheminement historique et qui révèlent donc une certaine autonomie cognitive. Nous proposons à présent d’analyser ces cas de figure plus précisément afin de les isoler et d’en montrer les particularités. 4. Reproduction de l’expérience visuelle sans association avec une expérience sonore Nous avons choisi les formes qui apparaissent comme les plus fréquemment usitées ou qui possèdent le plus de dérivés en espagnol et en français, sans prétendre ici non plus à l’exhaustivité. 4.1 La non-rectilinéarité Les dérivés du PIE *(s)ker (« tourner, tordre ») tels que fr. couronne/esp. corona, fr. cercle/ esp. círculo, fr. cirque/esp. circo, esp. cárcel (< lat. carcer-is « grille, treillis »), marquent une expérience visuelle de courbure (rotondité des formes) et/ou de lignes brisées (entrelacs de lignes droites) sans lien avec une expérience sonore. Parmi les dérivés, on note aussi la présence de fr. crépu / esp. crespo (< lat. crispus, dérivé de criso « tortiller »), ou encore de fr. courbe / esp. curva, fr. cirque, cercle / esp. circo, círculo. A cet étymon est également apparentée la racine *ker- « tête », « courbe », dont dérive cara « visage » en espagnol selon Corominas et Pascual (s.v.) (cf. lat. cere-brum « tête, cervelle », couronne). On le rapprochera alors volontiers de fr. crête /esp. cresta < lat. crista « aigrette, crête, huppe » provenant du radical indoeuropéen*k̂er(s) « poil dur/dru, coiffure ». On constatera dans tous ces cas que le caractère irrégulier des bords de la crête fait penser à la trace visuelle d’une fêlure. On notera également la présence de l’expérience visuelle de curvilinéarité mais aussi potentiellement celle, tactile, de dureté comme dans fr. cancer / esp. cáncer, fr. crabe / esp. cangrejo, tous dérivés du lat. cancer-is, et lui-même de l’indo-européen *kar- (« dur ») doublé en *karkar, devenu *kanker par dissimilation. On y ajoutera également les termes fr. crâne et esp. cráneo. La dureté marque en l’occurrence ce qui ne peut précisément pas se casser par rapport à d’autres éléments plus fragiles, soit un nouveau cas d’énantiosémie15 . 15 Chadelat postule aussi que la démarche latérale caractéristique du crabe peut avoir des conséquences dans sa conceptualisation et donc dans son entrée dans le champ de la non-rectilinéarité. Les dérivés du grec ancien κρυπτός, kruptós « couvert, caché », soit fr. grotte / crypte, crypto- / esp. cripta, cripto ont renvoyé premièrement à une expérience visuelle (ou à son absence rendue par l’occultation), puis secondairement, la grotte a pu être liée à la curvilinéarité ou à la courbure comme le propose Bohas (2021, cf. supra) du fait de la forme même de la cavité d’un point de vue externe. On retrouve également le croisement des lignes dans l’acception donnée par le CNRTL dans un emploi métaphorique, qui semble relever cette fois du champ de la nonrectilinéarité : « [a]bri de verdure, formé d'arbres entrelacés. » Le PIE *ĝher « tripe, intestin » a donné lieu à fr corde / esp. cuerda car la corde était originellement composée de cette matière. Or, au-delà de cette caractéristique, on observe ici aussi la mise en œuvre d’une expérience visuelle de curvilinéarité/circularité du fait de l’action commune de nouage mais également de sa composition plus contemporaine, soit un « [a]ssemblage obtenu par torsion de fils de matières textiles (chanvre, coton, laine, soie), synthétiques (nylon), métalliques ou autres (poil, crin, écorce d'arbre, jonc, etc.) […] » (CNRTL, s.v.). On retrouve approximativement la même expérience dans le cas de fr. courroie / esp. correa, du lat. corrigia / corrigium, dérivés de corrigo « corriger », du nom de la bride pour guider le cheval, et celui-ci de l’indo-européen *reg- 1 « conduire, remettre droit, ajuster », que l’on retrouve dans des vocables intégrant également d’autres paradigmes submorphologiques. Citons par exemple fr. diriger, rectitude / esp. diriger, regir, recto et leurs dérivés. En l’occurrence, cela montre deux réalisations énantiosémiques d’une même situation mettant en œuvre une rectitude et la rotondité nécessaire pour la maintenir16 . Quant à fr. croix et esp. cruz, ils proviennent du latin crux, crŭcem « gibet, croix », et lui-même peut-être du punique selon Ernoult et Meillet (s.v.). Ce terme correspond à une expérience visuelle de lignes brisées mais se présente également comme lié par l’expérience vécue à la souffrance, et au paradigme de cruauté, préfixe cryo- « froid », cristal (expérience de fragilité/cassure), de même que cru et croûte (< de l’indo-européen *kreu « sang, chair, froid »). Il ne s’agirait donc pas ici a priori d’un lien avec le cri lié au supplice mais avec la vision de la blessure et la sensation corporelle qui en découle. Cela se vérifie avec la polysémie de horca en espagnol évoquant à la fois la potence et la fourche et provenant du latin furca « fourche, bois fourchu, fourchon, poteau, support ». Dans ce dernier cas, comme en latin, l’expérience visuelle de non-rectilinéarité prédomine avec une possibilité d’emploi énantiosémique dans le sens de « poteau », un croisement supposant initialement deux lignes droites. L’espagnol carro « chariot » émane, quant à lui, du lat. carrus, celui-ci du gallois ou du celte carros « chariot à deux roues », en lien avec la racine indoeuropéenne *kers- « courir », qui a également donné esp. correr « courir », carrera « carrière », curso « cours » 17 . On constate ici l’expérience visuelle de curvilinéarité et proprioceptive de mobilisation des membres inférieurs. Il s’agit ici d’un autre exemple d’association énantiosémique entre la rectitude de la route et la rotondité des roues pour la parcourir, donnant lieu aux deux types de réalisations sémantiques en diachronie. On donnera pour finir l’exemple de fr. croustillant : il dérive de croûte (< *kreu « sang, chair, froid »), plutôt assimilé à une expérience proprioceptive et/ou visuelle pour sa rugosité (cf. lat. crusta « croûte, revêtement rugueux et durci », Ernoult-Meillet, s.v.). Cependant, croustillant réfère à une expérience sonore en synchronie actuelle (« qui croque sous la dent », CNRTL, s.v.) probablement héritée du caractère friable d’une croûte sèche. Ici aussi, la dérivation a marqué un changement de modalité pour le même lexème et illustre par là même la dimension bilatérale des liens entre non-rectilinéarité et cassure. Bien que cela ne soit explicité par aucun des dictionnaires consultés, on ne peut exclure l’influence des vocables du même réseau d’origine 16 A propos du lien acquis par l’expérience entre rotondité et rectitude, voir Grégoire (2021, 2022b). 17 Le croisement expérientiel avec une onomatopée n’est pas exclu, renvoyant par exemple au bruit de craquement du sable ou des pierres sous les roues, mais le fait que nous ne retrouvions pas d’emploi usuel, métaphorique ou phraséologique de carro relevant de l’expérience sonore est un indicateur de la prévalence des autres modalités. onomatopéique tels que crac / craquer, croc / croquer, cric, etc. En revanche, on notera que l’équivalent espagnol crujiente (< crujir « craquer ») est d’origine clairement onomatopéique (Corominas et Pascual, s.v. crujir), ce qui contribue à lui conférer des propriétés linguisticoculturelles distinctes. C’est ce que montrent par exemple les emplois métaphoriques tels que un livre croustillant, impossible pour un verbe n’endossant que la dimension sonore en espagnol. 4.2 La granularité et la gradation Il est intéressant de constater que plusieurs vocables renvoyant à une granularité ou à une gradation, mettent originellement en œuvre une expérience visuelle impliquant une certaine curvilinéarité. Tel est le cas tout d’abord de fr. grain / esp. grano qui proviennent du lat. granum, lui-même de l’indo-européen *ǵrHnom ou *g̑er « mûr, mûrir, grain », qui a donné corn « maïs » en anglais, par exemple. On retrouve ici l’expérience visuelle de rondeur du grain arrivé à maturité. Quant à fr. grumeau / esp. grumo, ils procèdent du latin grumulus signifiant « petit tertre », et lui-même de l’indo-européen *ger « tourner » où la dimension visuelle liée à la perception d’une rotondité est également patente. On retrouve également cette expérience dans l’étymon *gʷrendh- « gonfler, poitrine » de fr. grand / esp. grande, d’où βρένθος, brenthos « fierté » en grec ancien. Il s’agit en l’occurrence à la fois d’une expérience corporelle proprioceptive et d’une expérience visuelle de rondeur en 3ème personne. Pour ce qui est de gros, il provient du lat. grossus, et lui-même de l’indo-européen *gʷretso (« gros, épais »). Quant à gordo, il proviendrait peut-être de la racine apparentée *gʷurd « lourd » (Ernoult-Meillet, s.v. gurdus). On y retrouve la cohérence visuelle avec la rotondité ou la courbure du ventre ou du visage18 . Enfin, fr. degré / esp. grado proviennent de l’indo-européen *ghredh- « marcher, avancer », action qui peut engager également une rotondité dans la progression, comme nous l’avons constaté supra pour d’autres situations. Elle semble toutefois ici plus directement liée à la dimension proprioceptive du mouvement corporel qu’à la dimension visuelle. 4.3 L’expérience de contorsion du visage Tout d’abord, le vocable simagrées, datant du XIIIème siècle en français et employé régulièrement au pluriel, ne semble pas faire l’objet d’un consensus quant à son étymologie. Selon le CNRTL, [l]'explication par si m'agrée « cela me plaît ainsi » est anecdotique, et ne repose sur aucune attestation. On propose aussi un comparatif de sime a groe « singe avec des griffes » qui se serait formé dans le Hainaut […] ; ce serait une ancienne dénomination du diable; mais le flottement de la voyelle de la 2e partie du mot reste inexpliqué. Pour Guiraud (1994 : 484), les simagrées sont des singeries : sim (< lat. simius « singe ») + agrée « désigne donc une agrée « agrément, approbation, consentement » de singe. Soulignons donc simplement la présence du /m/ qui pourrait renvoyer à la zone bucco-nasale qui sert à sa prononciation et qui est mobilisée dans le cas de simagrées et couverte dans le cas de masque (par opposition à casque) (cf. Grégoire 2022b : 314). On constate dans tous les cas le lien avec l’expérience visuelle perçue en troisième personne. Quant à grimace, entré en langue française plus tardivement, au milieu du XIVème siècle, il provient du vieux-francique *grîma « masque » dont sont issus deux lignées de mots, l'une liée à la magie (grimoire, grimaud), l'autre aux expressions faciales (grimer, grime/grimace « contorsion du visage involontaire ou faite à dessein » (CNRTL, s.v. grime). On y retrouve l’anagramme de simagrées et il intègre selon toute vraisemblance le paradigme des mots en GR 18 Outre les travaux de Georges Bohas, on notera que pour Morvan (sans date), la racine préhistorique *gVb-, *kVp- possédait le sens de « forme convexe ou concave » et l’on en retrouve des dérivés dans le sens de « ventre » dans plusieurs langues : ossète gweben, ainou cuporo, sino-tibétain gèphu, austronésien kopu, basque sabel, kartvelle karb, korba. lié à la contorsion du visage. La motivation de ce terme pourrait alors se situer à plusieurs niveaux submorphologiques, celui du segment (cf. Nemo 2019) et celui du submorphème GR qui aura pu faciliter l’émergence du sens actuel. Pour ce qui est des formes fr. caricature / esp. caricatura, elles émanent du part. passé latin de caricare « charger (au propre et au fig.) », lui-même issu de carrus (< PIE *kr̥s-o-, de *k̑ers- « courir »), doté du suffixe -ure, « action de charger, charge » et au sens figuré « portrait ridicule en raison de l'exagération des traits ». Il s’agit là encore d’une expérience visuelle, certes tardive et imagée, mais sans lien avec la dimension acoustique. Enfin, les termes fr. aigre et acre / esp. agrio, acro et acre procèdent du latin acer et du latin populaire acrus, signifiant « pointu, pénétrant », et eux-mêmes émanent de la racine indoeuropéenne *ak- (« pointu, aigu »). Originellement, il s’agit donc ici d’une expérience visuelle et tactile qui est devenue ensuite gustative. Mais du fait de l’héritage sémantique lié à ces sensations, l’expérience visuelle s’est maintenue en troisième personne par l’expression faciale de dégoût associée à l’amertume. 4.4 La préhension L’expérience de la préhension – vécue en troisième personne comme un resserrement manuel mais aussi proprioceptivement et somatotopiquement – est largement associé à des actions, qui elles-mêmes sont génératrices de sons divers que rappelle la prononciation de /kr/ ou de /gr/. C’est tout d’abord le cas de fr. griffe, apparu au XIIème siècle, il représente un déverbal de griffer, lui-même emprunté du francique *grif, « action de saisir », auquel s’apparente également *krawjan (« s'aider de ses griffes ») qui a donné gravir en français. Ce terme justifie la cohérence entre la préhension et la gradation indiquée par degré, graduel, grand, progresser, par exemple. On ne retrouve cependant pas ici la présence de la dimension acoustique potentiellement liée au grattage. Il en va de même pour garra « griffe » en espagnol qui provient de l’arabe garfa « poignée » et qui était employé à l’époque médiévale sous cette même forme et doté du sens de « poignée, quantité de quelque chose que l’on peut tenir dans la main » (Corominas et Pascual, s.v.). Le Diccionario de Autoridades (1726-1739) donne ensuite comme définition précise celle d’« ongles des pattes des animaux car ils sont recourbés » (nous traduisons et soulignons), où l’on observe la convocation de la motricité visuelle reconstruisant une courbure. On constate donc qu’initialement l’action de préhension était la plus saillante indépendamment de celle de blessure ou de grattage et que secondairement celle de courbure s’est ajoutée en application métonymique aux griffes animales. La dimension sonore de l’expérience n’est donc pas prioritairement mise en œuvre ici. A la lumière des cas étudiés, on observe une certaine stabilité dans l’exploitation de la motricité visuelle depuis une époque très ancienne parmi les termes relevant du champ submorphologique en KR et en GR. On remarque par ailleurs que, dans certains cas, aucun rattachement à une modalité sonore n’est a priori recensé selon les dictionnaires consultés dans les cas exposés (e.g. dérivés de carrus en espagnol, fr. grimace, simagrées). D’autres ont connu un cheminement sémantique marquant un changement de modalités par le truchement de l’expérience, du visuel au gustatif (e.g. dérivés de acrus). Ces observations vont dans le sens d’une relative autonomie de l’expérience visuelle au sein des périmètres de KR et de GR pardelà son association possible avec des expériences sonores in situ. Ces cas tracent en effet une continuité dans l’exploitation de la modalité visuelle sans que celle-ci ne dérive de ou ne donne lieu à un changement de motricité. Or cela pose la question des fondements articulatoires de ce type d’émergence sémantique : existerait-il une cohérence directe entre l’aspect visuel du processus articulatoire et l’émergence d’expériences visuelles sur le modèle de ce que l’on constate avec l’onomatopée et l’expérience sonore ? 5. L’hypothèse d’une « onomatopée visuelle » ? La prise en charge de la multimodalité de la parole et de l’émergence du sens par le contact corps-environnement suggère que l’onomatopée repose sur l’extraction sonore d’une situation appréhendée de manière plurisensorielle en vue de constituer une motivation de premier degré (imitations dites primaires comme crac ou plus secondaires, lexicalisées, telles que fr. gorge). Un son est alors extrait puis reproduit pour être associé à une situation ou à un être. Par ailleurs, comme nous avons pu le constater, il existe une forme d’« onomatopée visuelle » de second degré, émergeant par métonymie par le truchement de l’expérience vécue et associée de manière aléatoire mais suffisamment fréquente à une appréhension relevant d’une modalité sonore. Or, si la modalité sonore est susceptible d’être extraite parmi un faisceau de sensations corporelles, pourquoi les autres modalités ne pourraient-elles pas, elles aussi, en être isolées ? Nous avons pu observer en début de travail que la construction de la parole (et donc du signifiant) repose sur un croisement inconscient du sonore et du visuel. Nous avons pu ensuite déduire ici que l’avènement du sens (et donc du signifié) repose parfois sur l’exploitation d’une seule modalité par métonymie (souvent également sonore et visuelle). Serait-il donc possible de postuler l’existence d’une exploitation métonymique de l’expérience articulatoire, ou mise en saillance (Grégoire 2018, 2022b) basée uniquement sur la dimension visuelle (ou proprioceptive) ? Nous allons soumettre ici deux hypothèses de correspondances entre l’articulatoire et l’environnement non langagier reposant sur la dimension visuelle, soit une iconicité de premier degré. 5.1 Retour sur le lien entre curvilinéarité et caractéristique dorsale selon Bohas Nous avons pu observer que, parmi les vocables du corpus, nombreux étaient ceux qui reposaient sur la convocation d’une expérience de rotondité ou de courbure, même les lignes brisées : les barreaux de la prison représentent des lignes entrelacées par torsion, par exemple. Sans prétendre extrapoler à l’ensemble des vocables du corpus ni légitimer l’hypothèse d’une dérivation courbure > lignes brisées en diachronie, il est tout de même important de ne pas occulter la portée de l’expérience de courbure/rotondité au sein du paradigme des mots en KR et en GR. La courbure ou la curvilinéarité font en effet partie des définitions de séries de vocables dérivés de *(s)ker- « courbe, tordu, arrondi » en indo-européen telles que la racine circ- (< lat. circum), fr. couronne/esp. corona, fr. cerveau/esp. cerebro, esp. cárcel « prison », etc., ou de la racine *gēu- (« tourner, courber »), comme le préfixe fr. gyro- ou le verbe esp. girar « tourner » (absents du corpus mais liés étymologiquement). Sur le plan articulatoire, il pourrait s’avérer possible de rapprocher la seule expérience de curvilinéarité de la caractéristique dorsale du /k/ ou du /g/ à l’instar de ce qu’a proposé Bohas. Si l’on reprend les termes contenant une réalisation formelle du submorphème KR ou GR cités par l’auteur, on constate en effet la présence de groin, gras, gros, graal (coupe creuse), grappin, grotte, grain, graine / granule, gourde, grume / grumeau, gargoulette, garrot, gorge, courbe, crête, excroissance, creuser / creux, crique, croc, crosse, cruche, crochet, crypte, cravate, crotte, carcan, corne, escargot, caracole (« escalier en colimaçon »), corolle, corbeille, cornet (de l’oreille), cor (excroissance), coronal, cornée, corset, caroncule (excroissance), couronne, arc, couvercle, cercle, arcade, cirque et autres dérivés du lat. circum, courge, crépu, chancre, crâne, croupe, goître, crouton, torquette « gâteau en forme de couronne », carbet « 1 Grande case faite de pieux et de branchages. 2 Terme de marine. Toiture pour abriter des embarcations », crèche « mangeoire à oiseaux », crampon, rectum, barrique, cucurbitacée (Bohas 2021 : 215ss). Toutefois, il s’avère nécessaire d’exclure ceux dont l’observation diachronique a montré qu’ils dérivaient d’une expérience sonore dans l’expérience vécue, soit gorge, goître, groin. Soulignons également que l’étymologie de crique (< vieux norrois kriki) est peut-être liée à une expérience sonore dans la mesure où elle est aurait pu être nommée ainsi en vertu de l’irrégularité de ses bords face à la mer (cf. crête), liée cognitivement à la cassure et à son bruit. Au masculin, cette forme désigne d’ailleurs un ruisseau au Canada, provenant possiblement d’une onomatopée *krikk. Quant à crèche (< francique *krippia), il pourrait émaner du bruit lié à la mastication quelque peu à l’instar de croquer, où le deuxième /k/ introduit les notions de dureté et de coup. On observe donc une motivation directe, intrinsèque, entre la courbure visuellement attestées de la langue lors de la prononciation d’une consonne dorsale et celle des objets désignés. Or cela correspond à la définition d’imitation d’un segment du monde par l’acte articulatoire, ce qui conduit à revisiter la définition de l’onomatopée du TLFi donnée supra en l’appliquant à la dimension visuelle : « création de mots par imitation visuelle évoquant l’être ou la chose que l’on veut nommer ». 5.2 La préhension et autres actions manuelles : la mise en saillance du geste d’ouverture-fermeture ? Nous avons évoqué plus haut les hypothèses de rattachement par l’expérience de resserrement manuel et du sentiment de colère selon Abramova et al. Or une autre hypothèse, prenant en compte la dimension proprioceptive de l’émergence du sens, a été proposée par Dennis Philps. Il a notamment étudié le lien entre la zone buccale et d’autres articulations corporelles en vue de leur nomination en proto-indoeuropéen. Il prend l’exemple de *gênu qui a d’abord désigné la bouche et la mâchoire puis le genou (> fr. genou, esp. hinojos) sur la base de l’analogie fonctionnelle et articulaire (ouverture/fermeture, abduction/adduction) avec l’organe de la parole (Philps 2006a). Par ailleurs, dans « From mouth to hand » (Philps 2006b), l’auteur a également montré que la nomination des parties du corps peut reposer sur la capacité présumée du cerveau à recréer de manière dynamique et empathique les mouvements répétitifs et dirigés vers un but, tant au niveau des mains qu'au niveau de la mâchoire, en synchronisant ces mouvements. Dans ces deux cas, la mise en saillance a pu porter sur l’acte d’ouverture/fermeture de la bouche (ou d’occlusion) pour des activités langagières et non langagières et, partant, non nécessairement sonores. Philps postule en effet le (presumably unconscious) use by Homo of oro-naso-laryngo-pharyngeal resonances mentally extracted from the anatomical actions in which they were embedded (breathing, biting, sniffing, swallowing, coughing, gaping, etc.) to refer back vocomimetically to these actions and to the effectors themselves, both internal and external (the lung(s), the jaw(s), the chin, the teeth, the lip(s), the nose, the pharynx, the larynx, the neck, etc.), e.g. the unconscious mental extraction from the complex, largely neuro-controlled anatomical action of ‘swallowing’, during which the epiglottis closes off the trachea as the tongue moves backwards and the pharyngeal wall moves forwards, of a glottal closure (transcribed phonetically as ʔ) to refer back to the action, and bodily self-reference, i.e. the use of these resonances, arguably incorporated into recombinable, structured segment groupings known as protosyllables, to refer to bodily actions other than those associated with the vocal tract and its effectors, e.g. nodding, gripping, nudging, kneeling, running and the corresponding effectors (head, hand(s), elbow(s), knee(s), leg(s)), unconsciously perceived as homologous with the actions and effectors of the vocal tract, for example the production of a CV protosyllable (Studdert-Kennedy & Goldstein, 2003 : 239-240), in which C represents an occlusive (close-open) resonance recruited to refer back vocomimetically to the manual action of grasping, i.e. a close-open movement of the vocal tract imitative of, and coordinated with, a close-open movement of the hand (Gentilucci et al., 2001, Philps, 2006 : 251; see also, for the notion of ‘sympathy’, Darwin, 1998 : 40). (Philps 2017 : 116-117) Ensuite, cette stratégie de nomination aurait été étendue à l’environnement en contact avec le corps (Iacobini 2009) puis à l’environnement plus éloigné. Cette hypothèse de Philps au sujet du proto-indo-européen va dans le sens d’une imitation proprioceptive (en première personne) pour la nomination de son propre corps puis de l’entour. Il existerait ainsi, selon cette hypothèse, une iconicité basée sur la mise en saillance d’une expérience visuelle en troisième personne et somatotopique en première personne d’actions langagières et non langagières opérées par la bouche (ici l’action d’ouverture/fermeture) et ayant émergé par analogie fonctionnelle avec d’autres parties du corps. Comme pour l’anglais (cf. supra), il se pourrait donc que les vocables référant à la préhension dans les langues romanes étudiées, la caractéristique saillante soit le trait occlusif caractéristique de KR et de GR. En l’occurrence, le resserrement / desserrement des mains marque effectivement une analogie avec le processus articulatoire correspondant à la prononciation des groupes prototypiques /kr/ ou /gr/ où les dents se resserrent mécaniquement afin de permettre le raclement de la vibrante : cf. e.g. *gerbʰ- « gratter » > fr. gratter, grapiller ; *ghreib- > gripper / agripper, grimper ; *(s)k(h)ai- > accrocher ; *(s)ker- > crisper ; *ĝhesor « main » < préfixe fr. chiro- / quiro-. Cela permet donc d’étendre aux mots contenant une occlusive sourde comme *(s)kreybʰ « tailler, sculpter » > lat. scrivere et ses dérivés dans chaque langue, fr. gribouiller ou fr. carte / esp. carta19 . Par ailleurs, on observe que la même racine indo-européenne *red- « gratter, racler, ronger », également composée d’une occlusive, renvoie à une action impliquant aussi bien la bouche que les mains20 et a pu donner lieu par exemple à esp. rascar « gratter, racler », arrastrar « traîner », rostro « visage », roer « ronger ». On détecte aussi *wrad- qui a donné notamment esp. arraigar « arracher ». Ainsi, d’un point de vue extérieur, en troisième personne, les expériences correspondant à ces actions semblent reposer sur la prépondérance de la motricité visuelle construisant le geste d’ouverture-fermeture. Et l’occlusion buccale utilisée à des fins linguistiques pourrait être saillante dans les situations précises établissant cette correspondance. Cette hypothèse aurait alors deux conséquences majeures : 1) le geste saillant ne serait pas le même que pour les autres termes des réseaux analysés, 2) l’expérience visuelle pourrait contribuer à la nomination sur la base d’une correspondance de même modalité avec l’expérience articulatoire21 . Conclusion Si l’on maintient la définition communément admise de l’onomatopée rappelée en début de travail, elle pourrait reposer sur la sélection et une exploitation métonymique de la modalité sonore au sein d’un environnement multimodal. De même, lorsque l’étymologie est avérée, l’analyse diachronique permet de définir les modalités exploitées originellement et, partant, les éventuels changements qui se sont opérés historiquement. La prise en compte de l’expérience vécue héritée du courant de l’énaction, a permis de dissocier les cas d’onomatopée de premier degré des cas d’onomatopées directement liés à d’autres modalités, notamment celle visuelle, dans les situations d’emploi. Nous avons pu également observer l’importance et l’autonomie relative de la modalité visuelle au sein des mots en KR et en GR, ce qui nous a conduit à explorer cette modalité de manière plus précise et à y appliquer les mêmes critères que pour l’onomatopée sur le modèle de Bohas. Cela a également permis de montrer que le processus d’émergence du signe linguistique a pu s’opérer selon la mise en saillance de propriétés articulatoires distinctes mais également de modalités précises perçues physiologiquement de 19 La mobilité du s- pourrait d’ailleurs marquer une instabilité et donc sa « non saillance » en diachronie, ce qui pourrait orienter l’analyse vers d’autres parties du signifiant. 20 Certes il s’agirait plutôt ici du submorphème TR lié à la rotondité et au parcours d’une rectitude mais le changement de réseau submorphologique en diachronie est rendu possible par les affinités expérientielles. 21 Le doute reste toutefois permis pour des cas dont nous n’avons pas pu vérifier la motivation originelle avec exactitude tels que fr. griffer, gravir, creuser et les termes dont le lien formel a été obscurci par les lois phonétiques, notamment en français, et qui ne se trouvent donc pas dans notre corpus (cf. e.g. fr. fragile, fourche, arracher). manière simultanée. L’onomatopée pourrait donc se présenter comme l’exploitation d’une motricité corporelle auditive ancrée dans une situation contextuelle multimodale. Il s’agit donc de considérer l’onomatopée dans son contexte multimodal de (re)production et, de fait, en complément des autres motricités exploitées. Or, comme le son est perçu consciemment, à tout le moins dans ses propriétés suffisantes à l’intellection du message, c’est la modalité sonore qui aurait pu être maintenue pour caractériser l’onomatopée au sens premier par antonomase22 . Nous avons en effet pu observer que des cas de mimétisme visuel (ou « onomatopée visuelle ») relèvent du même mécanisme de mise en saillance en vue de l’émergence du sensselon le même principe que celui de l’onomatopée « sonore ». Une autre conséquence théorique est que l’on ne peut pas rigoureusement caractériser le changement de modalités par la notion de transfert, comme le propose Chadelat inspiré de Lakoff et Johnson (1986). En effet, il ne s’agit pas de considérer le passage d’une modalité à une autre mais bien l’exploitation (ou l’extraction) de telle ou telle modalité au sein d’une situation pleinement vécue comme multimodale et constituant un faisceau d’expériences multisensorielles. On constate enfin que le submorphème peut se présenter comme une base assez stable d’analyse malgré l’hétérogénéité étymologique des vocables qu’il fédère. Des recoupements plus larges pourront permettre d’évaluer si d’autres cohérences existent entre, d’une part, les dérivations sémantiques (de nature métaphoriques ou métonymiques, par exemple) inscrites dans l’expérience vécue et, d’autre part, des mises en saillance successives portant sur des caractéristiques distinctes d’un processus articulatoire donné. Certes nous avons fait seulement porter l’analyse sur un échantillon d’un corpus déjà restreint sans prétention à l’exhaustivité. Nous n’avons par ailleurs pas quantifié la représentativité statistique de telle ou telle expérience sensorimotrice dans le champ conceptuel de KR/GR ni exploré les différences sémantiques correspondant à chaque variante submorphologique. Cette contribution prétend simplement confirmer et affiner certaines hypothèses antérieures tout en les appliquant au français et à l’espagnol. Il s’agit également d’insister sur le caractère de facto multimodal de l’onomatopée, souvent considérée comme strictement sonore. Références bibliographiques Abramova Ekaterina, Fernández Raquel, Sangati Federico (2013). « Automatic labeling of phonesthemic senses », Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society, 1696-1701. Barsalou Lawrence W. (1999). “Perceptual symbol systems”. Behavioral and Brain Sciences, 22, 577-609. DOI : http://doi.org/10.1017/S0140525X99002149 Bohas Georges et Saguer Abderrahim (2012). « Motivation accidentelle et motivation intrinsèque du signe Linguistique. Fragment d’un dictionnaire étymologique de l’arabe », ENS de Lyon. URL : http://matricesetymons.ens-lyon.fr/medias/fichier/motivation-accidentelleintrinseque_1401807990509-pdf (consulté le 21 juillet 2023). Bohas Georges (2016). L'illusion de l'arbitraire du signe, Rennes : Presses Universitaires de Rennes. Bohas Georges (2021). « Comment naissent les mots ? », Signifiances (Signifying), 5, Université Clermont Auvergne, 202-225. DOI : https://doi.org/10.52497/signifiances.v5i1.316. 22 Cette thèse ne va certes pas dans le sens (ou bien peut compléter) des théories biologiques et anthropologiques de la glotto-genèse recensées dans Jespersen (1976 : 399ss) et qui accordent aux sons la primauté dans l’émergence du langage humain : la « Bow-wow theory » (ou théorie de l’onomatopée), la « Pooh-pooh theory » (théorie de l’interjection), la « Ding-dong theory » (théorie de la résonnance) ou encore la « Yo-he-ho theory » de Ludwig Noiré (ou théorie des cris résultant d’un effort physique). Bottineau Didier (2003). « Iconicité, théorie du signe et typologie des langues », in Ph. Monneret (dir), Cahiers de linguistique analogique, 1, 209-228. Bottineau Didier (2009) La théorie des cognèmes et les langues romanes : l'alternance i/a dans les microsystèmes grammaticaux de l'espagnol et de l'italien. Studia Universitatis Babes Bolyai - Studia Philologia, LIV (3), 125-151. Bottineau Didier (2010). L’émergence du sens par l’acte de langage, de la syntaxe au submorphème, in M. Banniard & D. Philps. La fabrique du signe, Linguistique de l’émergence, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 299-325. Bottineau Didier (2012a). « Le langage représente-t-il ou transfigure-t-il le perçu ? », in F. Lautel-Ribstein (éd.), Formes sémantiques, langages et interprétations : Hommage à Pierre Cadiot, La TILV (La Tribune Internationale des Langues Vivantes), n° spécial, Perros Guirec : Anagrammes, 73-82. Bottineau Didier (2012b). « Submorphémique et corporéité cognitive », in D. Philps (éd.), la submorphémique, Miranda, 7. URL : http://www.mirandaejournal.eu/sdx2/miranda/article.xsp?numero=7&id_article=Article_13-446. Bottineau Didier (2013). « Pour une approche enactive de la parole dans les langues », G. Louÿs & D. Leeman (dir.). Le vécu corporel dans la pratique d’une langue, Langages, 192(4), 11-27. Bottineau Didier (2014). « Explorer l’iconicité des signifiants lexicaux et grammaticaux en langue française dans une perspective contrastive (anglais, arabe) ». Formes de l'iconicité en langue française. Vers une linguistique analogique, Le Français Moderne, 82(2), 243-270. Bottineau Didier (2017b). « Langagement (languaging), langage et énaction, a tale of two schools of scholars : un dialogue entre biologie et linguistique en construction ». Signifiances (Signifying), Langage et énaction : problématiques, approches linguistiques et interdisciplinaires // Enaction, émergence du langage, production du sens, 1(1), 11-38. ⟨10.18145/signifiances.v1i1.158⟩. Bottineau Didier (2017b). « Du languaging au sens linguistique ». Intellectica - La revue de l’Association pour la Recherche sur les sciences de la Cognition (ARCo), 2017, Langage et énaction : corporéité, environnements, expériences, apprentissages, 68, 19-67. Centre National de Ressources textuelles et lexicales (CNRTL). URL : https://www.cnrtl.fr/. (Dernière consultation le 26/09/2023). Chadelat Jean-Marc (2008). « Le symbolisme phonétique à l’initiale des mots anglais : l’exemple du marqueur sub-lexical », Lexis. La submorphémique lexicale, 2, 77-104. URL : http://screcherche.univ-lyon3.fr/lexis/ (consulté le 23/06/2023). Farina Maël (2020). Analyse lexicologique diachronique du profil phonosémantique des monomorphèmes en gr- dans l’Oxford English Dictionary. Sciences de l’Homme et Société. Mémoire dirigé par Mme Chris Smith et soutenu en 2020 à l’Université de Caen-Normandie. Fónagy Ivan (1983). La vive voix. Essais de psycho-phonétique, Paris : Payot. Grégoire Michaël (2012). « La polyréférentialité des vocables espagnols cuco, a et ganga », in P. Marillaud et R. Gauthier (éds.), L’ambiguïté dans le discours et dans les arts, Toulouse : Presses de Toulouse-Le Mirail, 2012, 357-388. Grégoire Michaël (2018). « Signifiant, signifié, saillance : le signe v(éc)u comme action », in Ch. Fortineau-Brémond, E. Blestel & M. Poirier (coords.), Le signe est-il diabolique ? Duplicité(s) du signe en question, Signifiances (Signifying), 2, Université Clermont Auvergne, 149-169. DOI: https://doi.org/10.18145/signifiances.v2i1.197. Grégoire Michaël (2021). « Le recours à l’expérience comme dépassement de la nonarbitrarité : vers une extension des potentialités de la Théorie des Matrices et des Etymons », in Danielle Leeman (coord.), La submorphologie motivée de Georges Bohas : un nouveau paradigme en sciences du langage. Paris : Honoré Champion. Grégoire Michaël (2022a). « Proposition de grille de lecture des groupes phonétiques du français », in M. Blasco & E. Auriac-Slusarczyk (éds.), Parler à l’hôpital : écouter ce qui est dit, décrypter ce qui se dit, Münster (Allemagne) : Nodus Publikationen, pp. 266-269. Grégoire Michaël (2022b). Les dénominations du visage en français et en espagnol contemporains. Approches énactive, submorphologique et linguistico-culturelle, inédit de dossier d’HDR sous la direction de Chrystelle Fortineau-Brémond, présenté le 14 décembre 2022 à l’Université Rennes 2. Guiraud Pierre (1986). Structures étymologiques du lexique français, Paris : Payot. Guiraud Pierre (1994). Dictionnaire des étymologies obscures, Paris : Payot. Iacobini Marco (2009). "Imitation, empathy, and mirror neurons”, Annual Review of Psychology, 60, 653-670. DOI : 10.1146/annurev.psych.60.110707.163604 (consulté le 23/09/2023). Jespersen Otto (1976). Nature, évolution et origines du langage. Paris : Payot. Lakoff George & Johnson Mark (1986). Les métaphores dans la vie quotidienne. Traduit de l’anglais par M. de Fornel avec la collaboration de J-J. Lecercle, Paris : Editions de Minuit. Leonardi Filippo (2015). « Phonesthemes in Latin language », Academia.edu. URL : https://www.academia.edu/17549917/Phonesthemes_in_Latin_Language_2015_ (consulté le 25/08/2023). Morvan Michel (sans date). « La racine linguistique *gVb, *kVp « creux ou bosse » : une fascinante racine préhistorique », Projet Babel. URL : http://projetbabel.org/basque/index.php?p=racine_gvb_kvp. (consulté le 30/08/2023). Pokorny, Julius (1959). Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, 2 tomes, Tübingen– Berne–Munich, A. Francke. Consulté dans sa version anglaise et électronique préparée par l’Indo-European language Association. URL : https://indo-european.info/pokornyetymological-dictionary/whnjs.htm (consulté le 28/09/2023). Philps Dennis (2006a). « Étude sémiogénétique des racines proto-indo-européennes *ĝenu- ‘mâchoire, menton’ et *ĝenu- ‘genou’ », in G. Bohas (dir.), L’iconicité dans le lexique, Cahiers de linguistique analogique, 3, Dijon : ABELL, 141-182. Philps Dennis (2006b). « From mouth to hand », in A. Cangelosi, A. D. M. Smith, et K. Smith (dir.), Evolang, The Evolution of Language, 6, New Jersey/Londres/Singapour : World Scientific Publishing, 247-254. Philps, Dennis (2008). “Submorphemic Iconicity in the Lexicon: A Diachronic Approach to English ‘gn- Words’”, Lexis, Lexical Submorphemics, 2. Philps Dennis (2017). “The emergence of the linguistic sign : vocomimesis, symmetry and Enaction”, Signifiances (Signifying), 2017, Langage et énaction : problématiques, approches linguistiques et interdisciplinaires ; Enaction, émergence du langage, production du sens, Signifiances (Signifying), 1(3), 115-132. DOI : https://doi.org/10.18145/signifiances.v1i3.114. Real Academia Española (1726-1739). Diccionario de Autoridades, édition facsimilée. URL : https://apps2.rae.es/DA.html (consulté le 08/09/2023). Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua Española, 23ème édition consultée sous sa forme électronique. URL : https://dle.rae.es/ (consulté le 01/09/2023). Tournier Jean (1985). Introduction descriptive à la lexicogénétique de l’anglais contemporain, Paris-Genève : Champion-Slatkine. Varela Francisco J., Rosch Eleanor, Thompson Evan (1993). L’inscription corporelle de l’esprit, traduit de l’anglais par V. Havelange, Paris : Seuil. Ed. or. The Embodied Mind, MIT Press, 1991. Versace Rémy, Brouillet Denis, Vallet Guillaume (éds.) (2018). Cognition incarnée. Une cognition située et projetée, Paris : Mardaga. VV.AA. (2001-2023). Etimología de CHILE. Diccionario Etimológico Castellano En Línea. URL : https://etimologias.dechile.net/. Dernière consultation le 26 septembre 2023.

Page suivante,
Cliquez sur : La clef du code
Date de dernière mise à jour : 24/11/2025
Questions / Réponses
Ajouter un commentaire